|
|
| La traduction de "La Divine comédie" de Dante par Jacqueline Risset dans la Bibliothèque de la Pléiade, 2021 |

Jacqueline Risset
|
Dante et la traversée de l’écriture
Peu d’œuvres sont aussi séparées de nous que la Divine Comédie :
plus proche dans l’histoire que l’Éneide,
où elle prend sa source, elle nous paraît cependant plus lointaine ;
commentée et répétée avec une érudition maniaque, elle garde à nos yeux son
secret. Mais c’est sans doute qu’elle est dissimulée au plus profond de notre
culture comme une tache aveugle : une énigme indéfinie dont la proximité
même nous rendrait inattentifs et bavards.
La question qu’elle pose est d’une telle ampleur que sa visibilité, encore
problématique, s’annonce peut-être seulement pour nous. L’humanisme l’a très
vite immobilisée et réduite à une référence culturelle dont seul un peintre,
Botticelli, semble avoir secoué la torpeur. Le classicisme, malgré Milton, n’a
aucune idée de ce qui est en jeu dans ce grand poème qui lui paraît barbare. Au
XVIIIe — mis à part Vico qui, en marge de son époque, élabore la Scienza Nuova dont
le titre est déjà un hommage à celui qu’il appelle "l’Homère toscan"
— un tel texte n’est déjà plus qu’une monstruosité illisible, inhumaine
(illisible veut toujours dire inhumain), un "salmigondis", précise l’Encyclopédie.
A ce moment, on pourrait dire sans paradoxe que Dante est aussi invisible que
Sade dont l’œuvre est probablement la seule à être à sa mesure. Le XIXe est
déjà plus hésitant : grâce à Schelling, Dante fait aussitôt partie de
la mythologie romantique qui, en France, en gardera surtout une image
décorative et spectaculaire où Dante et Enfer sont
deux termes synonymes confondus dans la catégorie du visionnaire et de
l’effrayant. Pourtant, c’est la rupture désormais traditionnellement marquée
par la seconde moitié du siècle dernier qui va faire de la Comédie une
présence formelle ("homérique"), le fond sur lequel va se dérouler un
déplacement et un renversement décisifs, liés à l’apparition du signifiant
comme tel, au langage comme question de plus en plus radicale.
Présence qui se manifeste de façon
contradictoire : Joyce et Pound en accentuent ce qu’on pourrait appeler le
projet microcosmique et globalement linguistique ; Claudel, bien qu’il y
trouve l’occasion de ses meilleures formules sur la poésie (qui ne "plonge
pas dans l’infini pour trouver du nouveau mais au fond du défini pour y trouver
de l’inépuisable "), veut, comme d’habitude, rassurer le parti catholique
qui n’a que faire d’un auteur aussi encombrant (aussi universel). Dante, à vrai
dire, se prête à tout ce qu’on veut : l’université, l’académisme et le
modernisme peuvent chacun le revendiquer sans grands risques. Or le problème,
bien entendu, n’est pas là (il n’est pas là non plus pour Hölderlin,
Lautréamont ou Mallarmé, et il y a longtemps, on le sait, que la pensée a
déserté ces classifications superficielles). S’il y a un "mystère"
Dante, si le surgissement archéologique de cette œuvre peut nous apprendre
quelque chose qui n’a pas cessé de déterminer invisiblement notre histoire, ce
n’est ni son apparence ni son contenu qu’il nous faut interroger, mais le
rapport profond que Dante entretient avec l’écriture. La Divine Comédie —
qui ne s’appelle ainsi de façon révélatrice que depuis le XVIe siècle ;
Dante, lui, dit simplement : "poème sacré" — va donc être pour
nous un texte en train de s’écrire, et plus encore le premier grand livre pensé
et agi intégralement comme livre par son auteur.
…
Philippe Sollers, 1965
L'écriture et l'expérience des limites, « Points » Seuil , n° 24
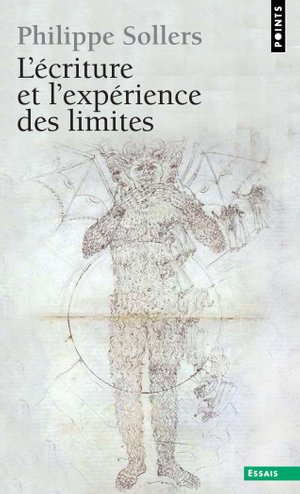
|