|
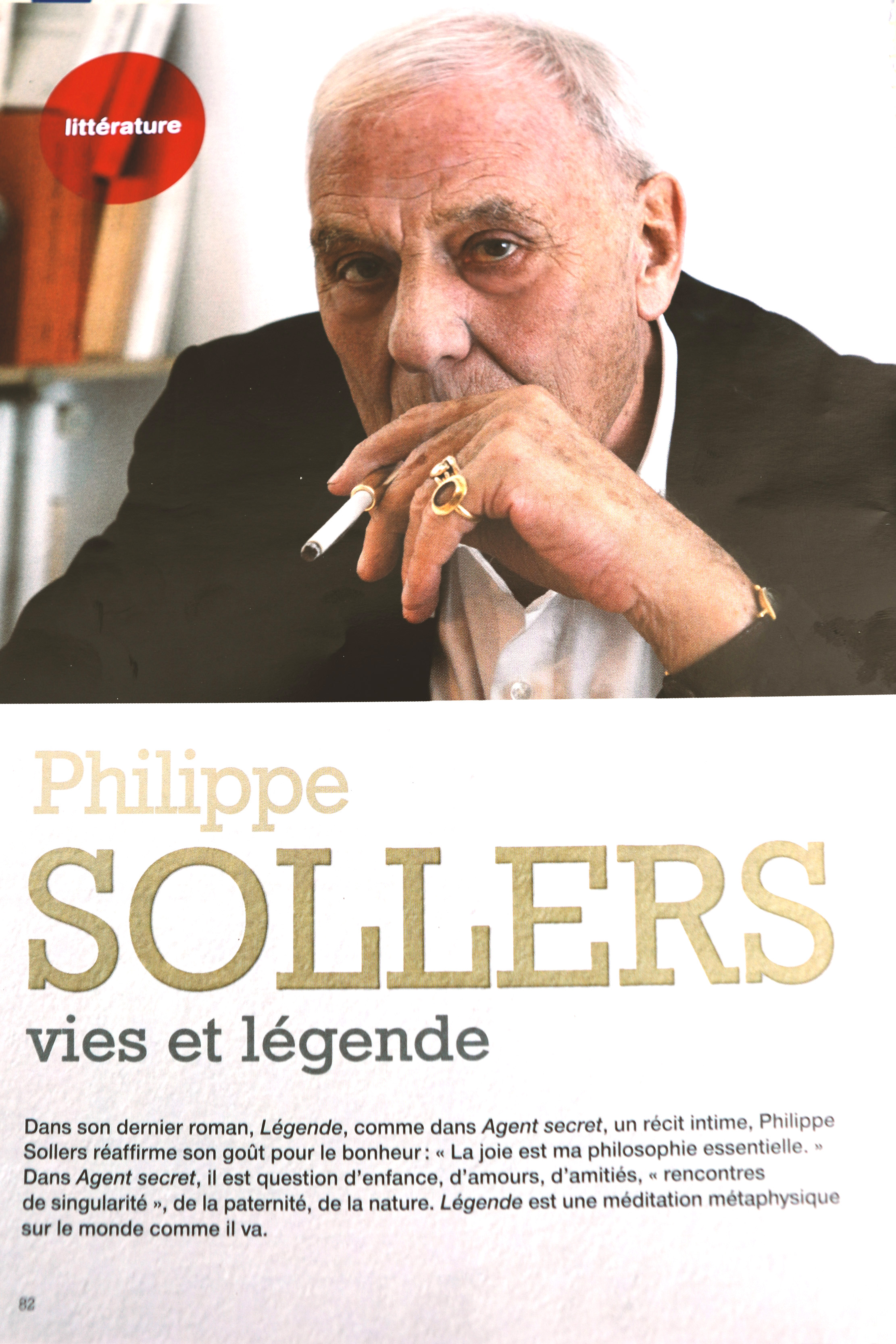
Josyane Savigneau :
Vous avez publié en mars deux livres, un roman, Légende, et un texte
très personnel, avec des photos, Agent secret, dans la collection
« Traits et portraits », que dirige Colette Fellous au Mercure de France. Ce dernier est très étonnant car il n’y a aucune fiction,
contrairement à vos Mémoires, dont le titre était Un vrai roman.
Vous avez mis longtemps à accepter la proposition de Colette Fellous. Pourquoi vous êtes-vous décidé ?
Philippe Sollers : À cause des photos. Comme je le dis des citations,
qui sont des preuves que l’on sait lire ou que l’on vit d’une certaine façon,
les photos sont des preuves. Il me fallait à un moment ou à un autre publier
des photographies. Un choix. Le contraire de ce que je viens de voir dans la
biographie américaine de Philip Roth, sortie aux États-Unis en avril. On a là
trois cahiers photos. Roth a eu le tort de donner à son biographe toutes ses
photos, et celui-ci n’a pas su faire le choix.
Les photos que j’ai choisies montrent une biographie qui commence évidemment
avant que je publie des livres. La société semble penser que je suis venu au
monde avec mon premier roman. Or, j’avais 22 ans. Et, avant cet âge, j’ai eu
beaucoup d’expériences, dont certaines photos portent l’empreinte. Les photos
sont des déclarations. Il y a des femmes, à commencer par ma mère, très
moderne, en avance sur son époque, et l’étrangeté de ses yeux de couleurs
différentes. Puis la merveilleuse Espagnole, basque, tout à fait réfractaire,
qui a été la première femme de ma vie. Dominique Rolin, dont la beauté n’est
plus à célébrer — on a publié quatre volumes de notre correspondance. Et Julia
Kristeva, dans un parc, je crois le Luxembourg. On dirait que montrer plusieurs
femmes de sa vie est encore gênant au XXIe siècle.
Ces livres traitent
chacun de nombreux sujets, mais dans les deux il est question de la paternité.
Dans Légende, d’un monde sans père qui s’annonce, et, dans Agent
secret, de votre paternité, de votre fils.
Des millions de personnes
ont récité pendant des siècles : « Au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit... » Est-ce qu’au lieu de réciter cela mécaniquement les
foules croyantes se posaient la question de savoir pourquoi il s’agit du père
et du fils, auxquels s’ajoute une troisième personne, à égalité ? Bien
sûr, c’est de la théologie, mais la théologie est passionnante, c’est un énorme
roman. Et je m’attache à le prouver. Le père, donc, a disparu au nom de la
technique, au profit du géniteur. Et pas même du géniteur au sens humain, mais
des produits permettant la reproduction.
Je parle de tout cela depuis longtemps dans mes livres. Cette fabrication des
corps à partir, si l’on peut dire, des matières premières m’intéresse. Je
m’étonne du peu de relief que cela a dans le roman contemporain. À part une
exception, My Life as a Man, de Philip Roth, qu’on aurait dû traduire non par Ma vie d’homme mais par « Ma vie en tant qu’homme ». C’est pour moi son plus
grand livre, qui parle du mensonge de la reproduction humaine.
Être père est une expérience que j’ai vécue intensément, dans la mesure où je
me suis senti brusquement tout à fait mort. C’est un fait que, pour l’humanité
en général, il n’y a de bon père que mort. Même si j’aime à citer la phrase de
Montaigne « le bon père que Dieu me donna ». Le père vivant est un
obstacle. À la possession des femmes, à la richesse, au pouvoir. D’où
l’invention du concept de patriarcat, combattu par toute personne révoltée en
son âme et conscience contre ce père qui occupe toute la place. On voudrait non
seulement qu’il soit mort, mais le tuer et le re-tuer
sans cesse. C’est le thème de la propagande qu’on a sous les yeux. Donc
« qu’est ce qu’un père ? » est une bonne question. Le père
humilié... L’absence de père... Le père prédateur... Freud est venu tout de
même jeter une lumière rasante sur cette affaire dans Totem et Tabou.
C’est le rassemblement des fils pour tuer le père et vivre enfin dans un monde homosexué.
Heureusement, dans Agent
secret, il s’agit d’une paternité plutôt heureuse. Deux des femmes de votre
vie, Dominique Rolin et Julia Kristeva — la mère de votre fils — sont juives.
Donc votre fils, David, est juif. Est-ce que cela a changé votre rapport au
judaïsme ?
Je ne raisonne pas en termes
de communauté. Me préoccuper de l’appartenance de quelqu’un à telle ou telle
communauté m’est totalement étranger. Mais s’il s’agit de parler d’une langue,
l’hébreu, et d’une culture ouverte sur l’étude, la lecture et l’écriture, bien
sûr, cela a pour moi le plus grand intérêt. Sans parler de l’histoire juive
dans l’Histoire, tragique et extraordinairement intéressante. Et je ressens
avec passion — mais ça, c’est religieux — le fait que, sans la Bible, il
manquerait une partie du cerveau humain : c’est une telle accumulation
d’histoires, de splendeurs, de crimes.
Dans beaucoup de vos
livres, notamment dans Paradis, on voit que la Bible a été l’une de vos
lectures constantes.
J’ai commencé à la lire très
tôt. Il y avait chez moi, à Bordeaux, plusieurs volumes d’une bible du XVIIIe
siècle, de vieux livres reliés en cuir et très illustrés. Pour le jeune garçon
que j’étais, cette découverte a été importante. Je n’en suis pas resté là, et
je m’étonne que la Bible, ce texte admirable, sublime, soit à ce point absent
de la culture française.

Le dossier de ce numéro
de L’Arche est consacré au bonheur. Or, en exergue de votre premier
roman, Une curieuse solitude, en 1958, on trouve ce mot de
Joubert : « Le plus beau des courages, celui d’être heureux. »
Et, dans Agent secret comme dans Légende, on en reparle :
« Se tenir à la joie est un principe de vie, une politesse, un
savoir-vivre « La joie est ma philosophie essentielle ».
Oui, j’ai persisté à travers
le temps. Puisque tout le monde — sauf ma famille, très important — me disait
le contraire. Le goût du malheur se porte bien. Le bonheur, en revanche, est
très mal vu. C’est pourquoi il faut s’arranger, si on en a les moyens, pour le
cacher. Il faut avoir une vocation d’agent secret. Et retourner le fameux
proverbe en « Pour vivre cachés, vivons heureux ». Nietzsche s’est
tué à dire que la santé essentielle était la joie. Évangile toujours nouveau.
La joie comme manière de
vivre, mais aussi le double comme manière de vivre. Il faut dire qu’il y avait
chez vous une prédisposition. Deux frères épousent deux sœurs et vivent dans
des maisons jumelles.
Agent secret... Agent double
ou triple, c’est encore mieux. Eh oui, tout était double, dans mon enfance. Et
j’ai vite compris que la dualité s’incarnait dans les rapports entre les hommes
et les femmes. C’est un conflit qui vient de loin et qui est exacerbé
aujourd’hui.
L’agent secret, vous et
d’autres y font allusion, c’est la figure de l’écrivain. Mais, dans ce
titre, Agent secret, et dans ce livre, c’est sans doute le mot
« secret » qui est le plus important. Vous êtes un homme secret,
« plutôt un homme sauvage, fleurs, papillons, arbres, iles. Ma vie est
dans les marais, les vignes, les vagues ». Au début et à la fin, on trouve
la phrase « être un oiseau ».
La nature est en ruine. Nous
— pour une fois, je vais dire « nous » —, humains, l’avons
collectivement détruite. Et nous vivons sous le règne de la contre-nature. On
peut lui donner le visage qu’on veut, et qui se résout dans la souveraineté de
la Technique.
Les oiseaux... Dans l’Antiquité, j’aurais peut-être été un augure, celui qui
« lit » les oiseaux. Ou bien un oiseau. De bon ou de mauvais augure.
Un oiseau, c’est la liberté, c’est un hors-la-loi. Les Chants du prince Vogelfrei, texte magnifique de Nietzsche. Les oiseaux
n’obéissent pas, ils se déplacent librement. Il est impossible de les
domestiquer. Bien qu’on en ait entraîné pour la chasse. Je suis constamment
enchanté de les regarder. Et, par eux, on sait ce qui est en train d’arriver.
Les mouettes, les goélands ont bien des choses à dire. C’est une telle leçon
que, en effet, être un oiseau...
Dans le récit de votre
enfance, il est beaucoup question de la maladie. Avoir surmonté de graves
maladies donne t-il un sentiment d’invincibilité ?
D’invincibilité, je ne crois
pas, mais, de ténacité quoi qu’il en coûte, certainement. Même si on est
vaincu, même si on est dans le coma, même si on se sent fou par moments, même
si on est en train d’étouffer à cause de crises d’asthme. C’est là où Proust me
fait signe, car voilà un corps qui savait de quoi il parlait. Pourquoi ne pas
être vaincu si la prochaine étape est un triomphe ?
Toutes vos rencontres,
dites vous, vos amours, vos amitiés, sont des « rencontres de
singularité ». Si l’on s’en tient aux amitiés avec des intellectuels,
Louis Althusser, Georges Bataille, Jacques Lacan et d’autres, est-ce que Roland
Barthes, qui a écrit un livre sur vous, Sollers écrivain a une place à
part dans ces rencontres de singularité ?
Oui, et j ’ai voulu le dire
dans un texte qui s’appelle L’Amitié de Roland Barthes. On n’était pas
d’accord sur tout, mais cela a été, avec des algorithmes différents, une
intense amitié. Et sa mort m’a laissé dans un grand chagrin.
Outre les rencontres de
singularité, et peut-être avec elles, la question de la clandestinité est dans
toute votre œuvre. Comme dans celle de Dominique Rolin. Vous dites :
« C’est la détestation de l’indiscrétion ».
L’indiscrétion est sociale
par définition. On l’ère du journalisme absolu, comme dit très bien Martin
Heidegger. Donc il faut qu’il y ait des révélations qui sont dues à
l’indiscrétion des uns et des autres. C’est un esprit d’inquisition permanent.
Pourquoi avoir placé le
roman Légende sous le signe de cette phrase de Machiavel :
« Heureux celui dont la façon de procéder rencontre la qualité des
temps » ?
Cette qualité des temps me
fascine. Que signifie cette façon de procéder ? Cela signifie que la façon
de vivre est un art — et c’est un remarquable politique qui parle, un homme en
exil. Pour un agent secret, ce que Machiavel a été, toute sa correspondance le
prouve, c’est essentiel. J’ai aussi choisi cette phrase car elle me renvoie à
une sorte d’exil. Je me sens rejeté et censuré par la communauté nationale à
laquelle j’appartiens, et à laquelle je déplais.
En exil, peut-être, mais
« censuré » est franchement excessif.
En effet, mais je pensais au Monde, le principal journal de la République. Restons à la
« qualité des temps ». C’est la manière dont on vit son propre temps
intérieur, à l’écart du faux temps social.
Le héros de votre
précédent roman, Désir, était Louis Claude de Saint-Martin, dit
« le Philosophe inconnu », qui a vécu pendant la Révolution
française, et que vous faites voyager à travers le temps. Légende est
plutôt une méditation du narrateur sur le monde comme il va.
Oui, le monde comme il va
mal. La tradition voudrait que certains romans français rejoignent le roman
philosophique. Ce roman a eu son heure de gloire, révolutionnaire. Maintenant,
nous sommes dans un tel chaos que je m’attache plutôt à ce que j’appellerais le
roman métaphysique, c’est-à-dire qui va à l’encontre de toute la négation de la
transcendance qui, à mon avis, devrait être ressentie par chacun et chacune.
C’est donc un enquête permanente sur le sacré, le
divin, les dieux.
Ce titre, Légende...
On pense à Victor Hugo.
Bien sûr, La Légende des
siècles. Mais on est sorti de cette obsession séculaire, et on peut se
demander qui sait encore de quoi il s’agit, « dans les siècles des
siècles », comme il est dit dans les messes catholiques.
Vous parlez dans Légende d’une qualité qui semble en voie de disparition : l’ironie. Et cette
phrase de Schlegel : « L’ironie est la claire conscience de l’agilité
éternelle, et de la plénitude infinie du chaos »...
C’est une parole du jeune
Friedrich Schlegel — il s’est par ailleurs converti au catholicisme, ce qui
n’était pas rien, à l’époque romantique. L’agilité éternelle qui permettrait de
circuler subtilement dans la plénitude du chaos. Il faudrait retourner du côté
de la théologie. Et revenir à « heureux celui dont la façon de procéder
rencontre la qualité des temps ». Comme nous sommes en plein chaos, tout
ça mérite d’être souligné. L’agilité est donc l’agilité qui peut sauver.
Philippe Sollers
Propos recueillis par
Josyane Savigneau
L’Arche, mai-juin 2021

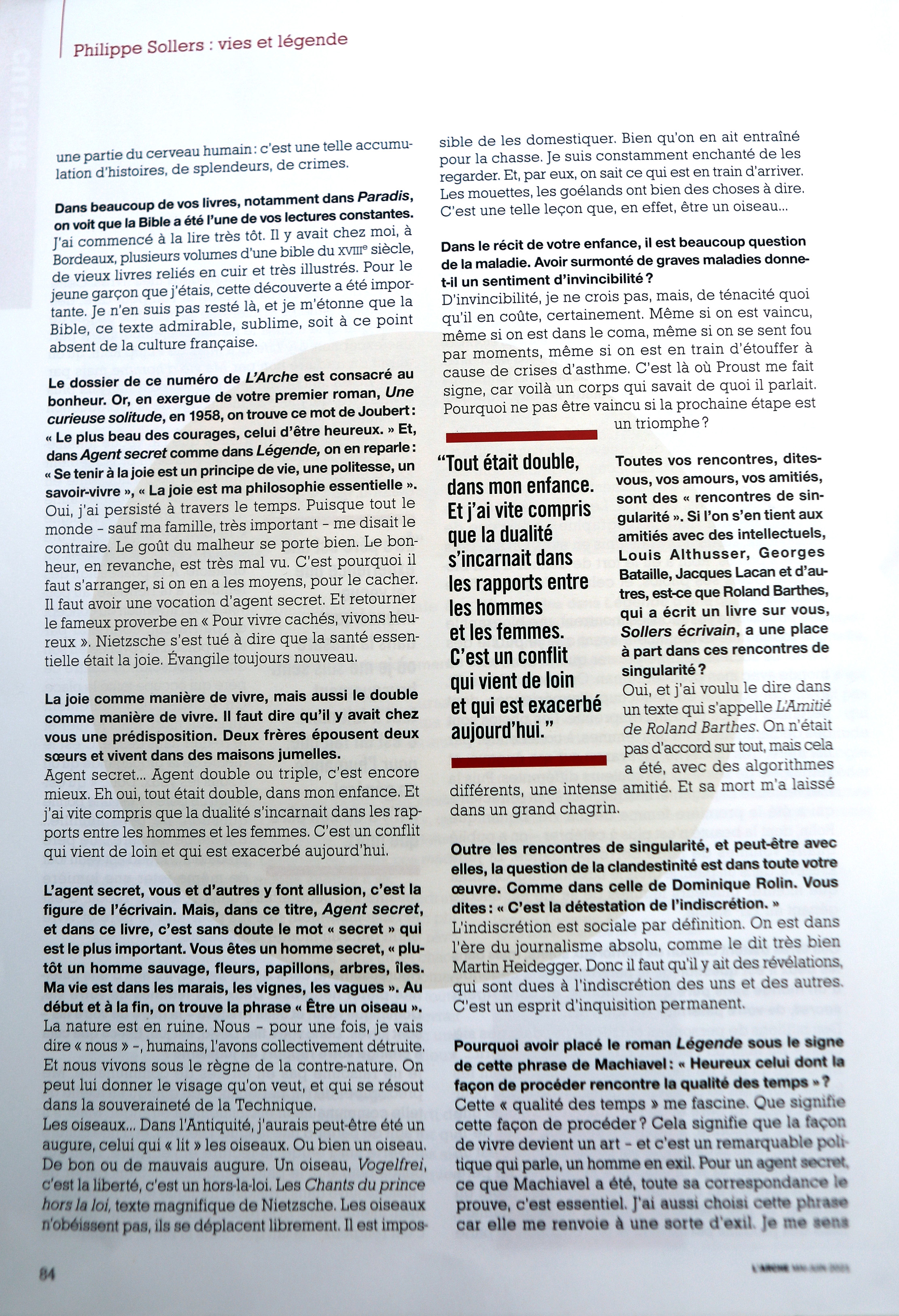
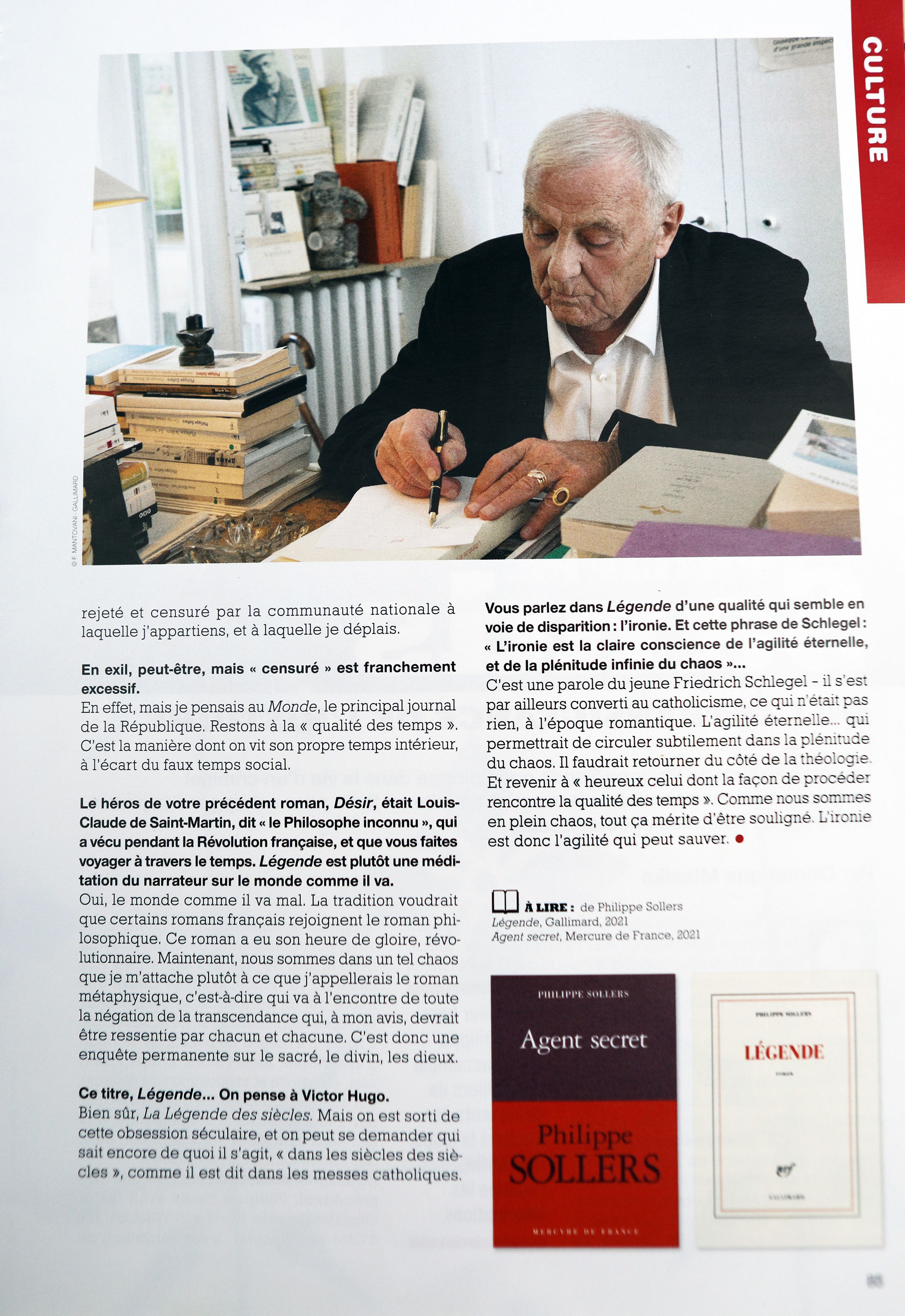
L'Arche, mai-juin, 2021, propos recueillis par Josyane Savigneau
|