|
|
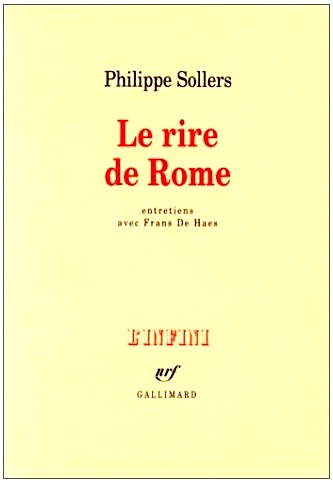
PHILIPPE SOLLERS
Le rire de Rome
Gallimard, L'Infini, 1992
Cela se passe à Paris à
la fin du vingtième siècle. Pourquoi les chemins qui mènent à Rome semblent-ils perdus, tortueux,
infréquentables? Du cœur de son œuvre, Philippe Sollers répond, relevant les propositions de lecture que je lui soumets
et les questions que je pose. La figure inventée au fil de ces
entretiens est nouvelle et va dans le sens d’une très grande liberté. Le propos
est direct, son rythme et sa profondeur se mesurent à l’humour, épreuve de
vérité. Comme le micro, les livres sont ouverts. Paradis, Femmes, Portrait du Joueur, mais aussi la Bible, Dante, Pascal, Loyola, Sade, Nietzsche,
Saint-Simon, Casanova, Joyce, Céline, Picasso, Proust, Homère, le Tao : on peut tout lire et tout dire. Pour que la
littérature et l’histoire reviennent, il suffit des bonnes coordonnées.
Frans De Haes
|
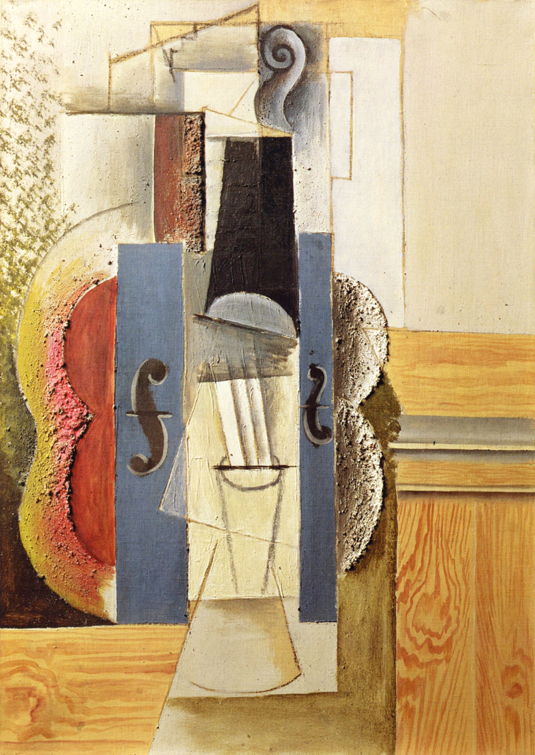
Picasso, Violon accroché au mur, 1912-1913
L’analyse infinie
Frans De Haes— Ce qui touche l’oreille d’un lecteur-auditeur un
peu exercé, c’est l’étendue des variations rythmiques et prosodiques dans Paradis, de même que sa technique (que l’on « sent » mais que l’on ne « saisit » pas
toujours) d’emboîter et de désemboîter les syntagmes
dans un phrasé à la fois très fluide et constamment interrompu. C’est là qu’on
entre au cœur de la jouissance infinie que Paradis propose et travaille.
C’est là aussi que les résistances surgissent, travaillent aussi... Je suis ici
particulièrement sensible à l’alternance entre des plages au phrasé plus ou
moins « normal » (apte au récit, à la citation, à la démonstration) et un
rythme abrupt-accumulatif (martèlement dramatique et satirique) où s’insèrent
souvent les fameux catalogues ou les « congeries »
pour reprendre un terme au traité de Du Marsais ; où jouent à fond aussi le
détournement, le détraquage des signifiants (ex. p. 53 : « échappant au phar au pharaon de l’on-dit aux momies cryptées du cigypte » — séquence se terminant sur un rythme
ïambique ou anapestique très récurrent dans Paradis)... Entre ces deux
patrons rythmiques (l’un plus discursif ou « romanesque », l’autre plus abrupt ou « poétique ») il faut, je crois,
en placer un troisième que je qualifierai approximativement de « juxtaposition
rimée des déterminants » ; ainsi dans le passage, p. 141 : « ils sont tracés
ils le sentent ils retombent frileux en attente neuvième cercle giudecca glacée personnages rectomés avalés broyés de nouveau mastiqués... » (je souligne). Certains passages alternent la juxtaposition et le discursif (p. 118
: « somnambulation du carné découpage fêté du poulet
pour madame la cuisse ou bien l’aile mi-poulet coquelet girouette dodue des clochers assurances gâteaux contredanses intimité
ou congés payés soma nous psukhé tribu tribunal
tridenté triste tripe contrivialité chaleur fourrée à
l’humaine voilà nous sommes faits de la même étoffe que les rêves et notre vie
s’arrondit en zéro dans la ronde étouffée des rêves... »); d’autres font se succéder le discursif, l’abrupt, puis le discursif encore, etc. Il y a
aussi, bien sûr, de longues plages purement narratives ou démonstratives (l’histoire
de Lola, p. 191-193, la fin du premier volume qui semble reprendre à la fois le
6e chant de Maldoror et le début d’Ulysse...). Comment cette
batterie s’est-elle mise en place?
L’approche que je suggère ainsi n’est pas « formaliste
» et ne pourrait l’être en aucun cas puisqu’à cette batterie rythmique complexe
correspond une énonciation constamment paradoxale, qu’il s’agit d’analyser
et dont le modèle de base serait l’affirmation: Je suis là et je ne suis
pas là. Je prends quelques exemples, plus ou moins au hasard : p. 53 : «
écrivant l’écrit s’écrivant au bruit des paroles n’écrivant rien tout en
écrivant sans arrêt n’écrivant que ce
qui était écrit en train de s’écrire » / p. 81 : « comme si on reculait comme
ça sans bouger tout en avançant» / p. 114 (à propos des saints) : « ils se sont
immergés en eux et hors d’eux » / p. 118 : « et ainsi peu à peu nous arrivons à
une antiperception de l’imperception à l’impôt renversé de l’interception » / p. 215 : « je suis moi dégagé de moi
bien en moi... » / p. 238 : « c’est-à-dire ne pas t’arrêter ou plutôt comme si
tu n’étais pas là mais branché alpha oméga c’est-à-dire ni là ni pas là au-delà
du là du pas là » / p. 241 : « pente à voix jamais là se tressant dérapant
au-delà du là » / Etc. Alors, deux questions. Premièrement : que signifie
cette manière d’être là/ pas là dans Paradis? Deuxièmement : pareille
enfilade d’affirmations, de négations et de négations des négations rappelle
bien entendu la logique théologique qui s’exprime notamment dans la séquence de
la Fête-Dieu (Lauda Sion) :
|
Un seul le
reçoit, mille le reçoivent
celui-là
reçoit autant que ceux-ci;
tous le
reçoivent sans le consumer
(...)
|
N’est-ce pas à la lueur de cette passion de la
contradiction comme langage et du langage comme contradiction qu’il
faut lire aujourd’hui votre traversée du matérialisme dialectique, de la
pensée chinoise et de la théologie ? Pareille logique — mais que signifie-t-elle
à chaque coup ? — travaille déjà votre référence à Chi-Tsang, Essai
sur la théorie de la double vérité, dans La Science de Lautréamont et votre référence aux Cahiers de Lénine
dans le même texte ; mais elle n’est sûrement pas étrangère à la logique de l’inconscient
freudien... Il y a là, visiblement et audiblement, une
fidélité à un projet bien au-delà des vicissitudes politiques, communautaires.
Comment voyez-vous ce projet et sa logique aujourd’hui ?
Philippe Sollers — La question est celle de l’infini. De l’approche
de cette question dépendent toutes les formes et toutes les transformations à l’intérieur
de ces formes. L’expérience de l’infini, c’est cela qui rassemble toutes
les subordonnées... et par conséquent le problème est tout à fait différent
selon qu’on inscrit, ou non, le chiffre de l’infini dans le langage. Il y a un
abîme entre se placer par rapport à un infini externe et être en train de
parler dans l’infini lui-même. Batterie rythmique, intensité, pulsation, fréquence...
ou bien : logique en expansion de la négation, ça revient strictement au même,
en ceci que si le poudroiement corpusculaire du langage saisi par l’infini
n’était pas susceptible d’un traitement logique extrêmement rigoureux, on
aurait tout simplement à faire à la simulation psychotique. L’être parlant
(parlant peu, car il s’imagine toujours avoir des organes silencieux), lorsqu’il
découvre, ça ne lui arrive pas souvent, que son corps lui-même,
substantiellement, est une erreur d’un langage qu’il ignore, devient
fou. A être fou on peut s’encanailler... Par là je veux dire qu’on peut feindre
la folie, c’est-à-dire que la question est posée de plein fouet de l’imposture
poétique. La définition du corps comme erreur d’un langage que le sujet ignore est posée de façon beaucoup
plus insistante dans le deuxième volume de Paradis qui traite plus
frontalement que jamais ce rapport de l’infini à lui-même bousculant toute
place organique. Il est logique que la psychose soit de l’ordre strict de ce
qui est bien connu par les cliniciens : la langue de fond qui se représente
pour le sujet divisé à vif sous forme de langue étrangère. Entre parenthèses :
cette division du sujet à vif, qui n’est autre que ce qu’on pourrait appeler sa blessure d’infini, dessine la possibilité — ou non —
pour un sujet de passer à travers toutes les langues, et il est repérable au
premier coup d’oeil si dans quelque texte que ce soit
on a cette possibilité... La différence entre Paradis et Finnegans Wake est là. Je dirais que Paradis est une machine (le terme est impropre mais enfin...) à traduire la traduction.
D’où cet effet assez étrange que tous les textes quels qu’ils soient pourraient
s’y retrouver améliorés, saisis dans leur nombril... à la fois rythmique
et logique. Nombril des rêves, disait Freud..., qu’est-ce que c’est que ce nombre de l’infini dans ce qui se dit ? L’infini, dit Hegel, c’est l’affirmation
elle-même. Pourquoi ? Parce que, ça saute aux yeux, c’est la négation de la
négation. « Omnis determinatio est negatio »... Spinoza... Voilà ce qui se lit à
la porte du Paradis : Vous qui entrez, laissez toute espérance, toute
détermination est une négation, tout fini n’existe que de nier, plus ou
moins passionnément, sa Cause. Ceci est essentiel, car c’est bel et bien de la
volonté forcenée — je dis bien : forcenée, infernale, se relevant
sans cesse, comme aurait dit Rimbaud, de la flamme avec son damné —, de
la volonté forcenée de nier la
négation de la négation que les corps s’empaquettent et font parade. Le hurlement des corps qui sont là, si on sait l’entendre..., ils ont l’air comme ça d’aller,
de venir, de s’occuper mais... ce sont des hurlements n’est-ce pas...
Certains, de temps en temps, s’entendent hurler en rêve : ça les réveille
pendant deux secondes. Le plus habituel c’est quand même qu’ils ne s’entendent
pas ronfler. Leur con-joint peut éventuellement les avertir... qu’ils étaient là sans aucunement s’en
douter sous forme pure et simple de groin. Les mourants font un boucan du
tonnerre. Où sont-ils pendant qu’ils font ce bruit ? Nulle part. Si on entend
ce hurlement on voit bien à quoi il s’adresse et de quoi il est fait. Il s’adresse
à l’infini. C’est ce que nous avons à lui dire,
à lui hurler que non, nous n’accepterons pas que lui, l’infini, nie la
négation que nous sommes. J’écris en partant de la fureur contre le
bruit qui feint d’être lui-même Histoire et de cette fureur naît, spontanément,
le rythme qui convient. Qui convient à quoi ? A la récusation de cette parole
folle et très raisonneuse (comme toute folie) consistant à nier l’infini.
Ouvrez des livres, regardez-les penser, voyez comment ils se situent par
rapport à l’infini et vous savez tout d’emblée. A un moment ou à un autre il
est fatal qu’ils prennent tous position sur cette affaire, le plus
comique dans le malentendu étant par exemple celui qui vous fait le coup de... l’infini
turbulent. A tous les coups, la confrontation à l’infini dévoile la
niaiserie sexuelle. A tous les coups. Le miroitement hallucinatoire que
vous pouvez vous donner selon la dose expérimentale qui vous convient, le flash Schreber si ça vous chante, le mi-froid mi-chaud à la douche écossaise relevée de champignons hallucinogènes, la peur d’un virus
verbal chamanique ou extraterrestre (Burroughs), ou alors la répétition, l’usure,
l’horizon métaphysique gris (Beckett) qui vient là se ruminer seul dans une
sorte d’entretien infini avec l’ombre de plus en plus vidée de l’envers.
F.D.H.
— Ne serait-ce pas là la
confusion entre la « rumeur » et « l’infini » ?
Ph. S.
— C’est cela. N’entre pas
dans l’infini qui veut. L’infini est catégorique. «L’infini est l’affirmation
absolue de l’existence d’une nature quelconque» (Spinoza). Son bon côté c’est
qu’il ne vous lâche pas l’incarnation comme ça. Rien de plus pathétique et,
encore une fois, de comique — d’où ces deux dimensions constantes
dans Paradis — récit ou scansion — que ces tergiversations.
Il y a une expérience qui me permettra tout de même
d’aller un peu plus au cœur de ce sujet, c’est celle qui s’est faite en
français de façon tout à fait spectaculaire (c’est le cas de le dire) pour
inscrire l’infini au point où le joueur de son propre corps calculerait comment
il doit jouer exactement ce corps. Déjà Dante le précise dans un moment tout à
fait clé du Paradis, n’est-ce pas, il ne peut aller plus loin dans ce fameux
voyage qui a commencé par la porte infernale dont j’ai parlé tout à l’heure, il
ne peut aller plus loin dans le Paradis qu’à condition, dit-il, de s’offrir
lui-même (lui qui parle, lui voyageur qui parle au moment même où il dit ce qu’il
nous dit) de s’offrir, donc, en holocauste. Ce qui veut dire qu’il doit décider
de l’abandon de toutes ses facultés physiques dans un anéantissement sans
reste. Holocauste, ça veut dire
sacrifice sans reste. Du grec holos, tout entier, d’où vient d’ailleurs le mot latin Sollers... Un hologramme, c’est bien ce que je fais... C’est la raison pour laquelle l’ombre portée
du Paradis qu’on lit n’est que la représentation en trois dimensions
visuelles de la voix qui traverse cette sculpture... Eh bien, ce sacrifice à l’intérieur
de la parole qui le raconte a été reposé sous une forme parfaite pour l’époque
(c’est toujours parfait pour l’époque si on s’y prend bien... l’infini a ses
époques... il faut trouver celle qui correspond au moment où l’on se
trouve) par... Biaise Pascal. Pascal dans son pari. Texte tellement
ahurissant que personne ne le lit, encore qu’il soit là sous nos yeux si nous
voulons. Il ne faut pas oublier que Pascal, mathématicien et théoricien
des jeux, spécialiste des cycloïdes et de la roulette, tellement en avance sur
les calculs de son temps qu’il finissait par se fatiguer de la médiocrité du
débat dans ce domaine, a décidé par conséquent de pousser plus loin en se
mettant lui-même en jeu... C’était plus drôle que de spéculer sur les
courbes... Eh bien, le petit mémorial cousu dans son vêtement — que j’ai
déjà comparé à la lettre volée par excellence — on pourrait repartir par
Poe, mais enfin... Ce mémorial, vous vous en souvenez, évoque deux heures de
feu où le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, vient pulvériser —
quelle pâque! — ce penseur au point qu’il en écrit fébrilement la trace
sur ce petit bout de papier qu’il coud dans son vêtement et qu’on trouve après
sa mort... tout ça est bien connu... Mais qu’est-ce qu’il écrit là-dessus? Qu’il
a trouvé le point de certitude qui implique qu’il sera, comme il a été et qu’il
est, « éternellement en joie pour un jour d’exercice sur cette terre ». Ça s’explicite dans le pari où les
commentateurs voient en général une mise en scène apologétique ingénieuse et un
peu pénible, mais parce que lesdits commentateurs ne comprennent pas que ce qui
leur parle là s’adresse bel et bien à leur déchet inconscient, à leur
merde même. Et que fait Pascal? Eh bien, il revient toujours, comme tous les
autres, avec un raisonnement sur la négation. Ce sera toujours d’un
raisonnement sur la négation que, d’autre part, viendra le feu dont j’ai
parlé en même temps que la trouvaille que l’infini déclenche dans le
forçage d’un sujet qui à ce moment-là échappe enfin à la folie qui constitue
son corps. Combien de fous pour que cet événement se produise! C’est
incalculable mais les générations humaines n’ont pas d’autre sens. Nous avons
quoi, dans le pari ? Le jeu de pair et d’impair, la convocation du
hasard, la scène métaphysique elle-même, sous la forme du « Croix ou pile ». «
Croix ou pile», on disait comme ça au XVIIe siècle. « Pile ou face »... «
Croix ou pile », ça dit bien ce que ça veut dire, si on veut recharger deux
secondes ces mots... piles atomiques... « Croix » comme forme minimale de la
signature aussi : si vous ne savez pas écrire, signez votre testament par une
croix. Un trait ne suffirait pas pour signer. Ça peut tout au plus vouloir dire
que quelqu’un a été là, ça serait le trait unaire. Mais pour marquer qu’un nom
aura été là — un nom ! pas « quelqu’un » !
— il faut au moins deux traits... croix ou pile... « Notre proposition,
dit Pascal, est dans une force infinie, quand « y a le fini à hasarder, à
un jeu, où il y a pareils hasards de gain que de perte, et l’infini à gagner...
» C’est très clair et parfaitement obscur. Vous vous rappelez, je n’ai pas le texte
sous les yeux mais vous me ferez l’amitié de le retrouver... Il faut voir
comment Pascal démontre quelque chose à quoi on ne peut échapper que par la
mauvaise foi. Tout lecteur du pari devrait, s’il était de bonne foi,
ressortir autre de la démonstration qu’il lit, sauf celui qui en passant
se dirait : eh bien, oui, ce Pascal il est tout à fait dans Y un des
coups possibles! Ce qui suppose qu’on comprenne parfaitement le raisonnement.
Mais faites l’expérience, faites lire le pari de Pascal et puis demandez
ensuite à qui vous voudrez de vous réexposer le raisonnement tenu. C’est drôle
: personne n’y comprend rien : le fini à hasarder, à jouer à croix ou pile, la
proposition qui est faite pour parler trivialement de se manger soi-même là
tout de suite de telle façon qu’il n’en ressorte pas autre chose que l’infini,
laisse le sujet pantois. Pourquoi? Parce qu’il est obligé à ce moment-là d’avoir,
s’il osait, la perception de lui-même comme merde. Les gens croient au
squelette, que voulez-vous... Le squelette... charmant... nécessaire aux
ébats érotiques... comme l’ont compris tant de peintres...
(...)
|