|
Lieux et formules
DIDIER
MORIN : La première fois que
nous nous sommes rencontrés, ici même, je vous ai donné Les Semelles d'or, un
livre que j'ai fait sur la géographie de Genet, dont Mettray est la capitale. En effet, j'ai parcouru ses lieux, ceux de sa littérature
durant quelques années. Je
me suis intéressé aux lieux de Genet, mais pas qu'aux lieux de Genet, aux lieux
en général. En vous lisant, je sais que vous vous intéressez aussi aux lieux,
et qu'ils ont une importance pour vous. Je dis quelquefois que les lieux sont
des êtres.
Nous
allons parler de cinéma, de vos films, d'art, de littérature, mais j'aimerais
avant tout que l'on parle de Bordeaux, du point de départ. Comme je connais très
mal cette ville, j'aimerais que vous m'en parliez.
PHILIPPE
SOLLERS : Je suis né à trois cents mètres à peu près du Château
Haut-Brion, c'est-à-dire entre Pessac et Talence, très exactement. Donc je
faisais beaucoup de vélo pour me rendre au premier lycée que j'ai fréquenté, le
Lycée Montesquieu, qui était à peu près à la campagne à ce moment-là. Et en
rentrant, je m'arrêtais au bord des vignes de Haut-Brion, qui est pour moi un
des plus grands vins qui ait jamais existé dans la famille - comme vous le
savez - des Graves. Il y a le Pape Clément, et Haut-Brion. Là, je peux vous
raconter beaucoup de choses sur la vigne, sa vie, sa respiration intérieure, et
ce qui va s'en suivre.
Comme
je vous le disais, je connais très mal Bordeaux, mais cependant j'ai pu noter
quelques noms de quartiers, de rues, de jardins. Je vais vous les donner et si
vous voulez bien réagir quand cela vous parle ?
Allez-y.
Le
quartier Saint-Augustin, celui de Saint-Michel ? Le marché des Capucins ? La
pelouse de Douet ? Le cimetière de la Chartreuse sur
les boulevards ?
Ça ne me dit rien. Rien du tout.
Les Chartrons ?
Ah oui, le jardin public. Oh,
admirable jardin public, à Bordeaux.
Très, très beau. J'ai une sœur qui
avait un appartement qui donnait sur ce jardin. Oui, ce qu'on appelle les Chartrons... Toute une légende là-dessus, bien sûr.
Le
centre de Pessac. C'est là où Jean Eustache...
Oui, mais Eustache n'était pas de
Bordeaux, comme vous le savez.
Oui,
je le sais. Il était de Narbonne. Je pensais à Mes petites amoureuses. Les
ruisseaux souterrains de Bordeaux ? Le Peugue et la Devèze ? Mériadeck, le quartier
des prostituées ?
Oui, ça oui, les prostituées de
Bordeaux, bien sûr. Enfin, pas seulement Mériadeck.
Vers les quais, enfin, les petites rues qui allaient à l'époque vers les quais.
Et
puis la Place Tourny, près de là il y a un jardin public.
Le jardin public est plus loin.
Vous avez là en effet la statue de Monsieur de Tourny, qui est un grand
personnage du lieu.
Mais enfin, parlez-moi plutôt du
Grand Théâtre ou de l'Opéra, là oui... Je suis souvent là. Emmené par les «
matinées classiques », comme on les appelait au lycée. Là j'ai vu bien des
choses : Boulez diriger Eschyle, par exemple, ou Madeleine Renaud jouant en
décolleté Marivaux, Les Fausses
confidences. Parlez-moi de la Colonne des Girondins. Parlez-moi des
Quinconces. Parlez-moi du Port, qui a ressuscité très récemment, et si vous y
allez vous serez très surpris de voir que Stendhal avait raison en 1825 - c'est-à-dire
à la fin du XIXème siècle, parce que le XIXème commence en 1825-1828 – d’affirmer
que c'était la plus belle ville de France. Ça lui rappelait un certain nombre
de quartiers de Venise, voilà.
C'est la plus belle ville de
France ! Elle a été longtemps punie.
Parlez-moi de la Place de la
Bourse, et pourquoi elle s'appelait Place Louis XV, et pourquoi personne n'a
osé lui rendre son nom. Louis XV, le roi qui a plu à Bordeaux contrairement à
Louis XIV ou à Napoléon. Parlez-moi de ce qui est magnifique, ou éclate le
XVIIIe siècle architectural. Ça oui. Parlez-moi de la Place
Gambetta, des allées de Tourny.
Parlez-moi du lieu où on a posé
après deux siècles seulement une plaque pour célébrer la venue d'un poète
allemand qui s'appelle Hölderlin... Je vais vous montrer cette plaque.
Elle
a été reproduite dans un numéro de L'Infini, je crois.
Oui. Il est venu en 1802. Cette
plaque date de 2002. Il a fallu deux siècles. Oui... « Les femmes brunes sur le
sol de soie ».
Saint-Maixant ? Le village où Mauriac avait sa propriété, Malagar ?
Malagar,
oui bien sûr, j'y suis allé une fois, comme ça, mais sans plus, parce que le
Saint-Émilion n'est pas le vin que je vais rechercher. En revanche, parlez-moi
de ce que les gens, ce que les paysans même appellent « la Gire », c'est-à-dire
la Gironde, c'est-à-dire tout le Médoc. Parlez-moi du mot Gironde. Parlez-moi
des Girondins. Parlez-moi politique. Et, la Gire, c'est-à-dire vous remontez
vers le haut, en traversant les Médocs, tous les grands Médocs sont là, vous
traversez Margaux par exemple, extraordinaire. Vous avancez dans un paysage
enchanté de châteaux où vous pouvez vous cacher, parce qu'ils ne sont pas
forcément visibles. Donc c'est un lieu de clandestinité, absolument
remarquable. Je sais où me cacher éventuellement, dans cette région.
Vous montez, vous arrivez à
l'Estuaire de la Gironde, là où la Dordogne conflue avec la Garonne, et où vous
pouvez assister au mascaret qui fait que l'eau devient rouge. L'eau des fleuves
et l'eau salée de la mer. À droite et à gauche, vous avez les vignes. Vous avez
les vignes très vertes, et le rouge qui avance rapidement vers vous. Ça oui, la
nature.
Quand vous allez à Bordeaux, vous
prenez l'avion et vous traversez la Loire, puis vous arrivez en Aquitaine, le
pays des eaux. Vous voyez tout d'un coup tout le sol miroiter, vous êtes dans
un lieu très, très particulier, qui comme chacun sait est le lieu le plus
éloigné dans l'hexagone de la France. La preuve, c'est que quand l'hexagone
s'effondre, tout le monde va à Bordeaux, pour se réfugier. C'est de là qu'est
partie la Massilia après le vote des pleins pouvoirs
de la Chambre du Front Populaire au maréchal Pétain. Donc, parlez-moi de ça.
Parlez-moi de politique, d'histoire, de la Gironde, des Girondins... On vient
de rééditer le livre de Lamartine: L'Histoire
des Girondins. C'est dommage, parce que vous ne connaissez pas l'histoire
de Bordeaux et l'histoire des Girondins, et l'histoire de pourquoi ce lieu -
les génies du lieu, génies au pluriel – a donné quand même un maire
considérable qui s'appelle Montaigne. À un lycéen on faisait visiter, vous
comprenez, la Tour de Montaigne. Moi, je regardais ce type qui s'était enfermé
avec des inscriptions latines sur ces poutres. C'était curieux. On s'égorgeait
sous ses fenêtres. Il avait peur des innovations calviniennes. Il est allé à
Rome pour vérifier si les textes grecs et latins étaient bien conservés par le
Pape Grégoire XIII. Oui, oui, ils étaient conservés.
Puis on allait à La Brède, là c'est Montesquieu. Il faut lire Stendhal, Voyage dans le Midi de la France. Et
donc, il y avait La Boétie, vous savez, De
la servitude volontaire, à relire tous les jours, parce que s'il n'y a pas
lieu de se plaindre d'une tyrannie, c'est parce que nous la voulons. Voilà, ce
sont des leçons inoubliables. Et puis il y a le cher Mauriac, qui n'était pas
bordelais mais landais, avec un caractère de Landais.
Ce qui crée un lieu, ce sont les
personnes. C'est le lieu qui élit les personnes. Genet a été élu par Mettray. Mais il n'y a que lui et vous sur ses traces.
Pourquoi a-t-il été élu par Mettray ? Eh bien, ça
donne l'homme de Jean Genet. Cézanne a été élu par la montagne Sainte-Victoire.
Vous y habiteriez, vous y prendriez des photographies, ce n'est pas le
problème, le problème c'est le motif, c'était le fait que Cézanne était là. Il
faut plutôt prendre les humains qui sont élus par des lieux, que dire, qu'ils
sont issus de ces lieux.
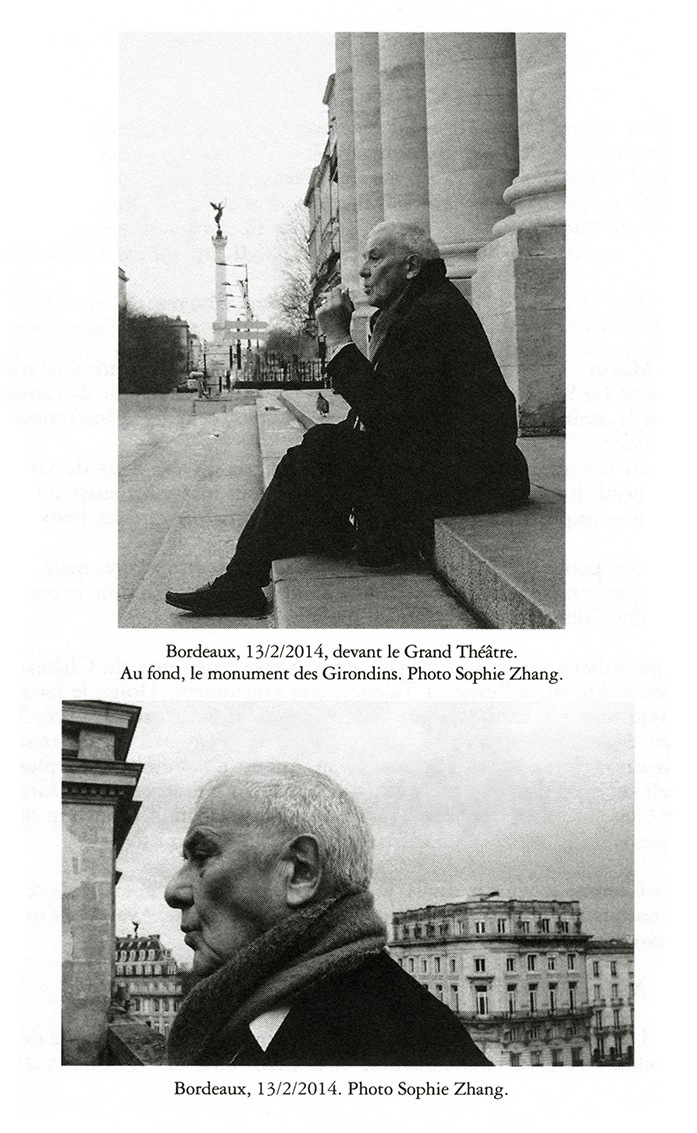
Pour
écrire Le Parc, vous avez été inspiré par un parc
bordelais, ou bien le parc de la maison familiale?
J'ai écrit ça dans une chambre
d'étudiant à Paris, à deux pas du parc Monceau où j'allais tous les jours. Par
la même occasion, j'allais aussi au Musée Cernuschi, pour voir des choses
chinoises. Les parcs ont toujours été, vraiment, un rêve pour moi. Que ce soit
Saint James, à Londres - j'aime beaucoup Londres - ou à Paris au parc Monceau
ou au Luxembourg où j'ai passé des heures.
De quoi ai-je besoin dans les
parcs ? C'est l'exergue des lieux composés. J'ai la plus grande admiration pour
les jardiniers français. Enfin, c'est Versailles... Le Nôtre, un génie ! J'ai
écrit sur la première biographie raisonnée de Le Nôtre. C'est la splendeur
totale. La mise en action ou en perspective, etc. Donc, ce sont des
mathématiques appliquées, et quand un lieu se prête à une mathématique forte, à
une logique d'inspiration mathématique, ça me parle immédiatement.
Et
ces paysages de vignes, rectilignes, aussi soignés que les jardins à la
française, ces longs alignements de ceps. Vous ne vous souvenez pas de paysages
lugubres l'hiver, ces masses sombres, un peu tristes ?
Tout dépend de l'architecture qui
est autour.
Savez-vous qu'au pied de chaque
plan de vigne, il y a toujours eu - enfin, c'est la tradition - un rosier qui
sert d'indicateur de climat ?
Donc, vous allez du Sud vers le
Nord, par exemple vous commencez dans les Sauternes... Alors là, vous pouvez
déjeuner, et vous commencez justement avec un Sauternes, le Yquem par exemple, vin admirable. C'est un vin blanc un peu sucré, que vous servez
glacé sur des huîtres, avec ce qu'on appelle des crépinettes, c'est-à-dire avec
un peu de saucisse. Ensuite, vous passez à autre chose, viande ou poisson :
l'alose, un grand poisson de la région. L'alose à l'oseille. Alors là, vous
changez de vin, vous passez au rouge. Vous continuez, et puis vous retrouvez
votre Yquem du début, qui est devenu à une température
chambrée, et à ce moment-là, vous avez des desserts. Vous retrouvez le sucré.
C'est-à-dire quelque chose qui renforce l'impression considérable de volupté
intime. Là-dessus, vous dormez d'une tout autre façon que d'habitude,
c'est-à-dire que le vin vous comprend, il vous inspire un sommeil qui non
seulement vous repose, mais vous éveille.
Vous savez, les gens là-bas, j'en
viens, ont un savoir-vivre très ancien. Ils ne disent pas grand-chose. On les
dit froids, non, ce n'est pas vrai, c'est tout simplement parce qu'ils sont
toujours à moitié ivres : British way, c'est-à-dire deux siècles de civilisation
anglaise. Attention ! Deux siècles. Et ça, c'est très intéressant. Donc voilà,
quand l'hexagone s'effondre, on vient à Bordeaux, et on va, comme vous le savez
sans doute, à Londres. C'est de là que de Gaulle a pris l'avion pour Londres.
C'est une région tout à fait
cachée aux Français. La preuve, c'est quand ils ne tiennent plus debout, ils
viennent là.
Il faut regarder les arrivées ou
les départs de population dans le Bordelais. Vous avez une imprégnation
anglaise bien sûr, traditionnelle. Vous avez des Irlandais ; j'ai une arrière-grand-mère
qui est irlandaise. Vous avez des Hollandais maintenant, etc. Et, ô stupeur !
Tout d'un coup, bien sûr récemment, les Chinois qui achètent les châteaux -
très sur le coup - et qui sont absolument passionnés par le cognac.
Je
me demandais ce que pouvait être l'esprit du lieu.
L'esprit, c'est la Colonne des
Girondins, vous savez, les Quinconces. Il faut voir l'activité de ce port, qui
a été grandiose. Je ne parle pas de la traite des esclaves. Hélas, c'est comme
ça.
La Colonne des Girondins a été
détruite. C'est l'un des premiers actes que les nazis ont perpétré à Bordeaux
lorsqu'ils sont arrivés. Nous étions en zone occupée, avec le sinistre Papon.
Mais la première chose qu'ils ont faite, c'est d'abattre la Colonne des
Girondins. Comme s'ils avaient été des Jacobins. Parce qu'à la fin des
Girondins, vingt et un députés chantent jusqu'à l'échafaud, et n'ont pas voulu
s'empoisonner alors qu'ils en avaient la possibilité : Vergniaud, quarante ans,
avocat à Bordeaux, Manon Roland qu'adorait Stendhal, avaient aussi du poison,
mais non, ils ont voulu mourir en révolutionnaires, face au peuple. Ils ont
chanté la Marseillaise jusqu'au bout. Le vingt-et-unième, qui chante encore
devant les vingt têtes de ses camarades dans la sciure, a un système nerveux
particulier. Vous ne croyez pas ? C'est très émouvant, c'est ce que Lamartine
appelle « le printemps de la Révolution ». Après ça... la Terreur.
La Révolution est un bloc ? Il ne
faut pas venir dire ça à un Bordelais. C'est l'une des plus grandes
falsifications de l'histoire. Ça n'est pas un bloc. Sauf un bloc de béton, et
vous vivez dans une falsification de l'histoire. Bordeaux, c'est ça. Bordeaux,
c'est un pied et une épine, et c'est une énorme épine dans le pied de la
République Française.
Nous nous sommes rencontrés à la suite du dossier que j'ai
constitué dans l'avant-dernier numéro de Mettray, consacré à La
Maman et la putain de Jean Eustache. Vous
aviez vu le film à l'époque?
Non, je ne l'ai pas vu à l'époque,
mais je l'ai vu récemment, à la télévision. J'ai été ébloui, absolument
ébloui.
Le
monologue de Françoise Lebrun, à la fin...
Absolument. Qu'est-ce qu'il a
senti ? Qu'est-ce qu'il a réussi à faire ? À capter, comme pratiquement
personne d'autre, sauf Hitchcock dans Les
Oiseaux avec Tippi Hedren,
ce qu'il en est réellement de l'hystérie féminine. C'est-à-dire, il a attendu.
C'est un film merveilleux, parce que vous vous rappelez qu'on fume beaucoup, ça
boit tout le temps, y compris dans ce fameux monologue, et que c'est
extrêmement fort d'avoir laissé tourner jusqu'à ce que l'actrice se décompose
sous vos yeux. Une présentation de malade, à laquelle même Lacan n'aurait pas
rêvé d'arriver. Donc c'est très fort, ça suppose une lucidité et une
impassibilité particulières. C'est un chef d'œuvre. Moi qui n'aime pas le
cinéma. Parce que je m'en fous, que c'est trop long et que j'ai tout de suite
compris de quoi il s'agit, sauf Hitchcock dont je peux revoir indéfiniment tous
les films, plan par plan, pour savoir ce que c'est un type qui pense ce qu'il
est en train de faire. Vraiment, c'est un très grand film.
André
S. Labarthe qui a fait un film sur vous, et avec qui je me suis entretenu au
sujet d'Eustache, et de l'époque à laquelle fut tourné La Maman et la putain, m'a dit qu'à l'époque il y avait deux
revues : Les Cahiers du cinéma et Tel
Quel. C'était la première fois que
quelqu'un me parlait de cette concomitance.
Je dirais cela dans l'ordre
inverse. Il y avait Tel Quel et Les Cahiers du cinéma.
Labarthe
me disait qu'à l'époque, un texte attendu à Tel Quel sortait
aux Cahiers du cinéma, et l'inverse
également, un texte attendu aux Cahiers du cinéma paraissait finalement à Tel Quel. Vous souvenez-vous de cette époque-là et de ces « passages » ? Et
cela semble encore vrai aujourd'hui, puisque dans l'avant-dernier numéro de L’Infini, Jean-Jacques Schuhl fait paraître un très bel entretien sur le rapport que son écriture entretient
avec le cinéma, paru d'abord aux Cahiers du cinéma.
Bien entendu. La différence
essentielle, c'est qu'un texte vaut aussi, et d'une autre façon que d'habitude,
à cause de son contexte. Donc un texte n'est pas le même selon le contexte. Or
cette revue d'écrivains s'est faite sur le texte même, pas sur les personnes -
les questions de personnes étaient nulles. Et un texte - je m'en rends compte
moi-même, avec le temps -, dans son contexte, c'est un autre texte. C'est ce
que nous avons démontré, ce qui n'est pas rien. Les Cahiers, il y avait des faiblesses. Tel Quel, je m'en souviens, il fallait que ce soit bon à 70%. C'est
énorme ! 30% pouvaient être discutés. Voilà. 70%, c'est beaucoup.
Les Cahiers, bien sûr, d'ailleurs, au moment où ça a commencé à
chahuter en 68, il y a eu fusion, il y avait Cinéthique aussi. Très, très
engagé sur le terrain politique. Fargier Jean-Paul :
l'as de la vidéo.
C'est
aussi vrai pour Méditerranée, de Jean-Daniel Pollet, la critique paraît
d'abord à Tel Quel, et je crois qu'il
faut attendre dix ans pour que Godard fasse quelque chose dans les Cahiers.
Oui. Mais c'est presque
contemporain. Godard vient de faire Le
Mépris, et Méditerranée c'est
1963, l'usage de la couleur est absolument fabuleux - l'œil de Pollet - et
Godard a aimé ça tout de suite. De toute façon le texte est de moi. Ce n'est
pas ma voix qui lit, mais le texte est de moi. Et le montage, à 58% aussi. On a
passé des nuits à monter ensemble. J'adore ça, monter, mixer. C'est un film
culte sur le plan du montage. Il n'y a rien à changer. J'en ai repris une
séquence de taureaux pour montrer ça à Bordeaux. C'est somptueux ! Le seul
bémol, à mon avis important, c'est la musique qui n'est pas ce qu'elle doit
être.
J'ai remonté les passages de Méditerranée, de la corrida, avec du
flamenco d'une fille magnifique, des années 20, 30, qui s'appelle La Niña De Los Peines.
Quand
avez-vous refait ce montage ?
Vous avez le film sur mon site.
(www.philippesollers.net)
D'accord,
je regarderai.
C'est somptueux. Mais il faut
changer la musique, parce que Duhamel est charmant, mais il avait fait une
musique genre concerto d'Aranjuez.
Non, ce n'est pas ça. Je suis très, très soucieux du son. De l'image aussi,
bien sûr. Godard est quand même quelqu'un qui est venu buter sans arrêt
là-dessus. C'est pour ça que c'est le plus grand.
Nous
allons parler de Pollet, nous allons parler de vos films. Toujours dans un
numéro de L'Infini, vous racontez que Pollet vient vous voir, qu'il a ces
images, il vient vous voir dans votre bureau et il vous dit : « J'ai fait ça,
mais je ne sais pas quoi en faire. »
C'était à mon bureau à Tel Quel. On se voyait dans la ville
aussi, on était amis.
Il avait filmé tout ça avec un œil
que, à mon avis, il est le seul à avoir eu. J'avais cru comprendre qu'il ne
savait pas bien si la fille allongée se souvenait d'un voyage... Enfin, on a
monté ça métaphysiquement. À partir de là, j'ai écrit le texte à l'aveugle. Ça
fonctionne à mon avis très bien. Cette orange qui est là, qui symbolise, si
vous voulez, le paradis perdu. Après quoi, je crois qu'il était content.
J'avais flashé de façon très forte
sur ce temple de Bassae, d'Apollon Épikourios, dans les montagnes grecques. Magnifique temple,
bleu, dans lequel s'engouffraient les nuages. Un lieu, alors, pour le coup,
absolument magique ! Donc il avait été saisi par Apollon, par la Grèce, et du
reste tout ce qu'il a fait sur la Grèce est absolument génial. Non seulement la
fille qui danse... non seulement ça, mais aussi les lépreux. C'est fabuleux.
Là,
vous parlez de L'Ordre.
Oui. Film fabuleux.
Là-dessus, il veut faire un film
sur ce temple, celui de Bassae. Je lui dis qu'il faut
prendre comme texte des Présocratiques, et lui fais quelque chose avec Héraclite
qui ne lui a pas plu. Alors il est allé demander à Astruc.
Il a fait un film quasiment touristique. Alors là, on s'est fâchés.
Vous comprenez, il n'y a pas photo
entre Héraclite et Astruc. Ce n'est pas possible. On
s'est fâchés, il a refait des choses avec Jean Thibaudeau, notamment un grand
film sur Ponge, qui a sa force, mais bon... Il s'est sous-estimé.
Des
paysages avec des ruines, les traces d'une civilisation disparue...
Oui. C'est la Grèce antique, en
même temps elle est tout à coup très populaire. Les
plans de la fille en train de reboutonner son tablier bleu clair, en se
coiffant dans le miroir, c'est parmi les images les plus proches de la
statuaire grecque que j'ai vues in vivo.
Sensualité de Pollet, admirable.
Absolument.
En effet, le plan de la jeune femme est d'une grande beauté. Quelle émotion !
C'est là où, à mon avis, c'est
supérieur même à tout ce qu'a pu faire Godard...
Même
si Le Mépris est un film sublime.
Oui, c'est un film sublime, mais
avec un côté sarcastique. Pollet, c'était un politique tout de suite... Le
lépreux vous parle d'on ne sait où. C'est la voix, le visage défiguré. Oh là là...
Alors,
nous allons parler des films que vous avez coréalisés, et de ceux dans lesquels
vous êtes acteur. Il y en a une quinzaine. Le premier, nous venons d'en parler
est celui avec Pollet, les derniers sont ceux réalisés avec G.K. Galabov et Sophie Zhang, qui est photographe, dont je vois
souvent les photographies dans L'Infini.
Oui. Ce sont mes archivistes, ce
sont mes amis et c'est avec eux que je monte ces films.
Avec
Pollet, on est dans le cinéma. Alors que ceux qui viennent avec Fargier on y est moins.
C'est vrai, moins déjà...
Et
puis il y a les derniers. Quel statut donnez-vous à ces derniers films, Médium, par exemple ?
C'est un prolongement, un
prolongement du livre. Mais La Porte de
l'Enfer, c'est encore du cinéma.
C'est
encore du cinéma, oui.
Nous avons fait monter un
échafaudage, qui est la seule façon de voir La
Porte de l'Enfer. Personne ne l'avait encore jamais vu. Tout le monde
passait devant sans rien voir.
Cet échafaudage, d'où j'ai failli
me casser la gueule dix fois pour filmer de très près toutes les figures. Je me
suis beaucoup occupé du montage, et du son. C'est-à-dire qu'il fallait de la
musique, et pas n'importe laquelle. Nous avons choisi des chants tibétains, et
le Requiem de Mozart. C'est un film
que j'ai réalisé avec Laurène L'Allinec.
Vous
dites que votre « number one », pour reprendre votre
expression, c'est Cary Grant pour les comédiens, et Hitchcock pour les
cinéastes.
C'est absolument indépassable.
Anne Wiazemsky dit dans son livre...
Oui, que j'aurais dû jouer dans La Chinoise. Godard y avait pensé, il me
l'avait proposé. On ne se quittait pas, on sortait beaucoup ensemble. Il
voulait que je tienne le rôle de Francis Jeanson qui
donne une leçon, et dit à Anne Wiazemsky, Véronique
dans le film, qu'elle doit faire ses études. Je n'avais aucune envie de prendre
ce rôle.
Ce qu'elle raconte est très drôle.
Godard disait : « Sollers est très, très intelligent ; il est aussi intelligent
que moi. » (Rires)
Et puis, quelque temps plus tard,
il lui dit : « Finalement, je crois qu'il n'est pas aussi intelligent que moi.
» C'est merveilleux comme histoire. Mais enfin, c'était un piège parce que
Godard est un manipulateur, aussi de génie, bon, voilà. Je n'avais aucune envie
de laisser une image de moi aux antipodes... C'est-à-dire de quelqu'un qui
faisait l'apologie des études scolaires.
Est-ce
que d'autres cinéastes vous ont demandé de jouer ?
Oui, il y a eu quelques
propositions qui étaient cocasses : il fallait que je fasse Louis XIV, je ne
sais plus... N'importe quoi. J'ai dit non.
Ce qui était très intéressant,
c'était les propositions - j'ai oublié les noms, mais j'en ai eu un certain
nombre - pour Femmes. Là, j'ai vu ce
qu'il était possible de faire ou de ne pas faire au cinéma.
Pourquoi
?
Il fallait toujours, sur le thème
« l'homme qui aimait les femmes », vous voyez, Truffaut, etc., que le narrateur
se souvienne d'une vie antérieure. Et là, j'ai chaque fois dit non. Il s'agit
au contraire de filmer l'existence libre d'un homme dans la nature féminine. Enfin,
c'est le sujet, non ?
L'existence libre d'un homme n'est
pas possible au cinématographe, Monsieur !
Mais une chevauchée fantastique
allègre dans le paysage, y compris des natures féminines, qui ne se traduise
pas par de la violence, ou des récriminations, ou des drames de la guerre des
sexes - c'est exactement ce que j'expose, c'est-à-dire un maximum de liberté,
non ? - je vous assure que ce film ne sera jamais fait nulle part. Ou alors
satire, mais pas de façon endiablée, non.
Le cinéma a ses contraintes :
l'argent. Donc j'ai dit non.
Vous
avez dit non, vous avez refusé plusieurs demandes.
Ça ne m'intéresse pas, il y a eu
des conversations, et puis non. Mais j'ai tourné dans une petite séquence de
Rohmer : j'achète une chemise aux Champs-Elysées. Paris vu par. Je rentre et j'achète une chemise ou un pyjama... je
ne sais plus. Une chemise, je crois. (Rires)
Tout petit second rôle.
Je
sais que dans le cinéma, vous n'accordez pas plus d'importance que ça à l'image,
ou disons moins d'importance à l'image qu'au son.
La leçon de Debord est considérable : « Je me flatte de faire un film avec n'importe quoi et je
trouve plaisant que s'en plaignent ceux qui ont fait de leur vie n'importe
quoi. » Le texte est superbe. La voix c'est lui, c'est ça, une voix. Un peu
nostalgique. In girum imus nocte et consumimur igni, de 1978 est
un chef d'œuvre. Je l'ai vu, il y avait trois personnes dans la salle, là,
juste à côté. Or je considère que c'est un très grand film, selon ce que
j'entends par film, moi, c'est-à-dire le son d'abord... Et le texte. La musique
et le texte.
Il
y a une voix dans le cinéma français d'aujourd'hui qui vous intéresse ? Que
vous aimez entendre ?
Non. Je trouve que les actrices
françaises sont en général désastreuses, sauf l'autre soir à l'Odéon il y avait
Isabelle Huppert qui a été absolument merveilleuse, qui lisait un texte de
Julia Kristeva sur Sainte Thérèse d'Avila. Elle a complètement intégré le rôle,
c'était du grand cinéma. C'était très intéressant. C'est la plus intelligente. Sinon, elles ne sont pas très intelligentes (dit en murmurant). La plus intelligente
que j'ai rencontrée, actrice de cinéma, c'est Glenn Close. J'ai été la voir à
New-York, on a parlé assez longuement dans sa loge. Elle était absolument
délicieuse. Elle jouait une pièce de théâtre idiote. Et on a parlé, eh oui, des Liaisons dangereuses. C'est la seule,
toutes les autres se sont plantées. Il n'y a qu'elle qui tienne le coup.
Système nerveux considérable. Maîtrise. Intelligence ! Grande intelligence.
Ah oui ! Glenn Close en peignoir
bleu... Bon, la maîtrise de la situation est complète. Ça c'est très, très
rare. Les actrices en général ne sont pas très intelligentes. Godard a fait ce
qu'il a pu, mais enfin, bon.
On
ne va pas donner de noms...
Ah ! (Exclamation et rires) Eh bien, écoutez, j'ai un ami dont je ne
citerai pas le nom qui m'a dit : « Comment se fait-il que tu puisses aimer les
femmes intelligentes ? Moi, elles me font peur ». Je lui ai dit : « Moi, je
préfère. C'est plus pervers, donc je préfère. »
«
Je crois que ce qui me dérange le plus c'est l'image. On tombe dans un
formatage très ancien qui consiste à confondre l'image et la peinture. » Vous
l'écrivez dans un texte paru dans L’Infini.
Cher Morin, j'ai vu ça lors d'une
grande exposition Titien au palais des Doges à Venise. Les tableaux sont très
grands. Les Japonais entraient, photographiaient, mais évidemment ils
n'arrivaient pas à cadrer exactement et ils se réunissaient ensuite, tous, à
l'accueil pour voir une vidéo sur les tableaux. Alors que ces tableaux... J'aurais
voulu dormir là. J'ai eu droit à
une visite privée, j'ai pu regarder ça très longtemps.
La peinture, il faut dormir avec,
il faut vivre avec, il faut la regarder à différentes heures. Et le fait de
transformer la peinture en image est un crime, tout simplement.
Il y a des réussites, parfois,
d'explication didactique de la peinture, par exemple dans Palettes d'Alain Jaubert, où un type qui s'appelle Obalk, qui a fait parfois des trucs à la télévision qui ne
sont pas mal du tout, vous montre comment un tableau est composé. Bon, c'est
bien, mais ce n'est qu'une explication didactique.
Le fait de vivre avec la peinture,
vous comprenez, ça veut dire qu'on se transforme, on a envie de vivre dans le
tableau qu'on est en train de toucher, parce que ce n'est pas seulement la vue,
la peinture.
La peinture parle. L'œil écoute,
comme a dit quelqu'un de fort inspiré à ce sujet. C'est Claudel.
Les textes sur la peinture
hollandaise sont formidables. Comme par hasard, les meilleurs textes sur la
peinture sont français. Vous pouvez vérifier. C'est très, très étrange. Il y a
une façon d'aller vers la peinture qui tient à la langue elle-même, que ce soit
Mallarmé sur Manet, que ce soit Artaud sur Van Gogh, que ce soit Bataille sur
Manet...
Sur
Lascaux aussi. Que se soit Sollers sur De Kooning...
Que ce soit Aragon sur Matisse.
Cette coalescence entre la poésie, ou l'art de l'écrit et la peinture, c'est
absolument français. Vous n'avez rien d'équivalent dans aucune autre culture,
sauf peut-être là (Philippe Sollers me
montre du doigt un rouleau au mur). C'est un poème qui se lit de haut en
bas et de droite à gauche, c'est un superbe poème que j'ai rapporté de Chine,
et qui est inspirant car vous voyez que vous n'avez pas le droit au repentir
dans la calligraphie. Vous voyez par exemple, là, vous sentez tout de suite le
poignet, l'épaule, le souffle, et le fait que ça raconte un homme qui en
cherche un autre à travers la montagne, il y a les fleurs, les oiseaux, voilà.
Les Chinois... Ce qui m'intéresse
c'est que Picasso a dit ça, un jour : « Au fond, j'aurais pu être un artiste
chinois. » Vous voyez ça, par exemple, là, vous levez les yeux (Philippe Sollers vient d'ouvrir un ouvrage
sur Picasso). Ça ce sont les derniers Picasso qui ont beaucoup choqué les
Américains : en haut, vous avez le Violon de 1912, c'est pour Eva, jolie Eva - c'était le grand amour de sa vie, elle est
morte en 1915 - en bas vous avez un tableau merveilleux qui s'appelle Les Amoureux, et si vous regardez de
près en haut à droite, il y a « Manet » écrit de la main de Picasso. Personne
ne parlait plus de Manet en 1919, personne.
Nous
reparlerons tout à l'heure de Picasso, mais si vous voulez bien, nous allons continuer
à parler de vos films.
Alors,
après le film avec Pollet, vous disiez qu'il y avait eu ce court passage dans
le film de Rohmer, Paris
vu par, puis sept films avec Fargier dont deux versions de Paradis.
Oui.
Il
y a la performance entourée des huit moniteurs vidéo. Un dispositif imposant.
Et puis, il y a une autre version qui dure une cinquantaine de minutes,
réalisée en 1983, Sollers
au Paradis, où vous êtes en gros plan,
voire en très grand plan, lisant Paradis,
avec des images de Venise qui défilent derrière vous, et puis des images
pornographiques.
Lire Paradis était une épreuve. J'ai maigri de quelques kilos. Il y
avait un prompteur, et donc j'avais une amie qui déroulait le prompteur. Elle a
fini quasiment évanouie, et moi aussi. Voilà.
C'était très dur. Parce que je
refuse en général que mes textes soient lus par quelqu'un d'autre que moi. J'ai
fait une version d’Un Coup de dés jamais
n’abolira le hasard de Mallarmé qui tient en sept ou huit minutes, en le
chuchotant presque, comme ça. Très rapide. Voilà, je crois en la puissance de
la voix, à travers les images. Ce n'est pas la voix qui sort de mon corps,
c'est mon corps qui sort de la voix. Voilà, c'est ça que je dois faire
absolument sentir. Parce que tout cela est sur fond de texte aussi...
Bien
sûr.
Il y a des livres, hein ?
Il
y en a... À l'époque de Paradis, vous êtes beaucoup à New York.
Vous vous intéressez à la peinture américaine à ce
moment-là, qui vous semble très « ouverte », dites-vous.
Oui, c'était le moment... Oui, à
New York... Ça doit être vers 1973… Je vois De Kooning, rencontre très
importante.
Oui,
j'allais vous en parler. Il y a une très belle photographie dans un Peinture cahier théorique. Vous êtes dans un musée à New York et vous
posez devant deux magnifiques tableaux de De Kooning.
Et puis, il y a ce long et très beau texte paru dans La Guerre du Goût, où vous évoquez votre rencontre. C'est à
votre retour de Chine.
Je l'ai vu dans l'hôpital où il
était en cure. Il y avait son marchand qui me recevait. J'ai des souvenirs
épatants. J'ai été voir son atelier à East-Hampton etc., mais lui était en cure
de désintoxication...
Oui,
vous en parlez dans votre texte.
Il délirait complètement, ivre-mort,
il était à l'hôpital, assis sur le bord de son lit, et il m'a parlé de
Tintoret. Pourquoi pas. Il y avait un truc zen auprès de lui. Oh, et d'une
beauté considérable. Oui, j'en parle dans Femmes.
Une
très belle rencontre.
Rencontre très, très électrique.
Lorsque
vous lisez Paradis, je parle de la performance avec Fargier, c'est la voix qui vous intéresse. Je pense à
d'autres voix et d'autres textes, Artaud, Luca, etc. À des textes qu'il faut
entendre...
Puisque plus personne ne lit rien,
il faut - je l'ai anticipé - revenir à une sorte de
performance orale, et revenir à l'oralité, profondément. Parce qu'on peut
imprimer 600 livres par an, 600 ou 700 romans par an, dont 3 seulement
survivront, et encore... C'est fini, d'une certaine façon. Il faut que vous
ouvriez un livre pour l'entendre. Enfin, pour l'entendre même... pour
l'entendre en lisant avec les yeux, mais si vous ne l'entendez pas...
Je reçois des manuscrits, et je
vois tout de suite s'il y a une voix ou pas. Les gens avec qui je travaille
trouvent que je suis vraiment trop sévère. Je ne me plie pas à lire tout le
manuscrit, c'est très vite vu. Si la voix n'est pas là, il n'y a rien.
Oui,
bien sûr.
C'est comme au conservatoire. Le
type qui monte sur scène, joue quelque chose ; si les mains ne sont pas là,
l'aura n'est pas là non plus. C'est très vite vu. C'est pour cela que c'est la
poésie qui compte avant toute chose.
Et quand quelqu'un ne va pas bien,
je lui dis : vous pouvez prendre des médicaments si vous voulez, vous devriez
apprendre des poèmes par cœur, et vous les récitez. Par exemple, prenez La
Fontaine, Baudelaire... Baudelaire : admirable antidépresseur : « Sois sage, ô
ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille ». Le fait d'entraîner sa mémoire est
quelque chose, je vous assure, de considérablement important dans l'époque où
nous vivons. Ma femme qui est psychanalyste, sait de quoi elle parle, et elle
me dit qu'elle est très frappée par le fait que les patients et les patientes
se plaignent - entendez-moi -, se plaignent de ne pas pouvoir mémoriser la page
qu'ils viennent de lire. Par conséquent, si vous ne l'entretenez pas, ce muscle
de la mémoire, si vous passez votre temps en communication sms,
texto, ou dans ce qu'on vous raconte pour vous cacher ce qui se passe : à la
télé, à la radio, etc., vous perdez quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire une
présence à soi qui passe évidemment par des mots, « les courses, les chansons,
les baisers, les bouquets », voilà, ça c'est Baudelaire - « Le vert paradis des
amours enfantines/ Les courses, les chansons, les baisers, les bouquets (...)
». Vous avez quatre mots, disposés d'une certaine façon. Eh bien, écoutez : moi
ça me comble.
Et la peinture et la poésie, c'est
la même chose : Ut pictura poesis ; le dernier mot de Picasso à l'agonie
c'est : « Que devient Apollinaire ? » Ce sont des rencontres essentielles !
Bacon est inspiré par Eschyle, voilà pourquoi ses triptyques invraisemblables
de violence sont si admirables ! Les poètes... La poésie, la peinture, la
musique, c'est pareil. Il ne devrait pas y avoir de séparation entre les sens,
entre les cinq sens, voilà. Il faut que tout joue en même temps. Alors, le
cinéma peut vous en donner parfois l'idée lointaine, mais pas vraiment assez
sensuelle pour vous convaincre que ça pourrait être touchable, respirable, et
entendu réellement. Voilà, c'est tout.
Revenons
à Paradis, au film. Que vous reste-t-il de cette
époque si fertile en expériences ? Cette fulgurance, cette imagination, cette
liberté même... Que vous reste-t-il de la fin des années 70, juste au moment de Paradis ? De la peinture américaine de De Kooning, et en France ?
Paradis, c'est en 1981. J'ai fait ça à New York.
Vous savez, c'est une trajectoire
qui se poursuit ailleurs.
Qui
se poursuit ?
Autrement, mais de la même façon
en même temps. Le même reste le même, mais change évidemment pour rester le
même. Enfin, voilà.
Que me reste-t-il ? Tout.
Dans
la peinture française de l'époque, dans Support-Surface et les autres courants
d'avant-garde.
Oui, mais écoutez, ça... (Philippe Sollers feuillette un volume, et me
montre une image de Lascaux.)
Comment on appelle ça... ? Les
chevaux chinois. En 1955, vous avez quelqu'un qui a été l'une des plus
impressionnantes rencontres de ma vie, c'est Georges Bataille. Il venait me
voir à mon bureau de Tel Quel.
En 1955 il écrit deux livres, coup
sur coup : un sur Lascaux, éblouissant, un autre sur Manet, éblouissant aussi.
J'ai lu ça à l'époque, j'ai pris ma voiture - Lascaux était encore ouvert au
public - j'ai foncé sur Lascaux. Voilà. Et alors, comment est-ce qu'un type
pouvait avoir tout à coup une aussi grande ouverture... Lascaux, on va dire
c'est 25 000 ans, et Manet c'est quand même hier. Oui. Mais tout cela est
vivant !
Alors, vous avez quelque chose de
nouveau... De « nouveau », oui, enfin, d'industriellement nouveau, si on peut
dire, comme dirait Benjamin. Mais vous avez quelque chose de nouveau,
c'est-à-dire une sorte de prodigieuse accumulation d'art, en mettant les
guillemets, contre laquelle de temps en temps j'ironise.
Le type qui a tout compris, c'est
Warhol. Vous n'achetez pas de l'art avec de l'argent, vous achetez de l'argent
avec de l'art. C'est une mutation très importante dans les habitudes qui
étaient classées, parce que jamais Picasso n'aurait imaginé que les marchands
créeraient les artistes, de toutes pièces.
Attendez, ce qui résume tout c'est
la pancarte qui était à Hong Kong récemment : une très jolie Chinoise affichait
une pancarte qui était la suivante : « Money creates taste », l'argent crée le goût. Ce n'est pas vrai, évidemment, mais c'est
merveilleux comme aveuglement.
Je
pense à l'anecdote qui concerne un achat de Picasso. Je ne sais pas si vous la
connaissez. C'est le marchand suisse de Picasso qui lui demande au téléphone
comment il va, et Picasso qui lui répond : « ça va, j'ai acheté un Cézanne. »
Alors son marchand lui demande lequel. Picasso lui répond : « l'original. » Il
venait d'acheter la face Nord de la montagne Sainte-Victoire. Il était à
l'époque à Vauvenargues, là où il est enterré.
Non, je ne la connaissais pas. Ce
qui est beau aussi, c'est le marchandage avec Rubin. Rubin voulait acheter la
Guitare préparée de Picasso, pour une somme... Non. Mais si je vous donne un
Cézanne à la place ? Alors là, d'accord. C'est-à-dire que ça n'a pas de prix,
vous comprenez.
Bien
sûr.
On fait du prix, mais ça n'a pas
de prix. Toutes les évaluations servent à la bourse. Évidemment, vous avez
plusieurs marchés maintenant, ça devient compliqué. Parce que si un Jeff Koons arrive à exister, bon... Mais tout le monde sait que
c'est le dernier acheteur qui va être floué. C'est-à-dire qu'il faut que ça
circule. Au XXIe siècle, c'est nouveau. Il faut être quand même un
peu plus marxiste que d'habitude, si je puis dire. C'est-à-dire que la valeur
d'échange a pris quand même le pouvoir. Et sur la valeur d'usage, je parle
vraiment du B-A-BA, il faut voir comment ça fonctionne. Un écrivain qui ne
s'intéresse pas à la façon dont fonctionnent les marchés financiers aujourd'hui
me paraît pénible, enfin ! En tout cas, qu'il n'en parle pas. Je ne peux pas
vous dire exactement ce qu'il se passe en ce moment aux Îles Vierges, cher
Monsieur Morin, ni aux Îles Caïmans, je reviens du Luxembourg, je ne peux pas
vous dire que j'ai vu quoi que ce soit, sauf des gens charmants, d'ailleurs,
qui m'ont reçu de façon tout à fait idyllique. Là, vous sentez que l'Allemagne
est en train d'utiliser le Luxembourg, peut-être de loin, de très loin. Quand
je vous fais ça (Philippe Sollers claque
des doigts), combien de milliards ont disparu ? Vous ne le savez pas, mais
ça retombe en pluie fine. Alors, tout est en disponibilité, comme a dit - oh...
je vais citer son nom... quelle horreur ! - comme a dit quand même Heidegger,
c'est-à-dire c'est la mise à disposition de tout. Pourquoi croyez-vous que
Heidegger soit si pénalisé et re-pénalisé, pendu tous
les matins ? Parce qu'il a dit des choses essentielles... Sur ce trafic de
l'animation culturelle. Alors, il faut parler d'argent, sans quoi... Godard, en
privé, parle d'argent, oui !
Oui,
oui, dans l'entretien que vous faites avec lui, il parle de l'argent, et il dit
que c'est la part maudite de l'art.
Bataille, toujours lui. Mais
l'entretien avec Godard n'a jamais été diffusé à la télévision, je vous le
signale. Alors qu'avec Duras, oui, ça a marché....
Absolument. Vous savez pourquoi ?
Ça ne s'est jamais passé. Or c'est
intéressant parce que c'est au moment de Je
vous salue Marie - c'est Fargier avec deux
caméras - je lui fais dire des choses, très belles. Il me demande pourquoi je ris...
Oui, je sais, il dit : « Moi je pleure et toi tu ris. »
Pour quelle raison ? Parce que ça
pense un peu !
C'est le mot de Warhol, « acheter
» est un verbe américain, pas « penser ». Où est-ce que ça pense un peu ?
Dites-moi, j'irai tout de suite, comme j'allais autrefois écouter Lacan qui
improvisait ce qu'il pensait en parlant. C'est le plus beau théâtre que j'aie
jamais vu. Étonnant ! Il avait une très nette tendance à penser.
J'ai l'habitude maintenant de
parler comme ça, voilà : Untel a tendance à penser, « tendance », je dis bien «
tendance ». Ou alors, ce qui est équivalent, presque, Untel ou Unetelle à
tendance à être honnête (Silence).
Vous voyez, c'est très bon de se poser des questions comme ça.
Ou alors, troisièmement, ce qui
est intéressant chez tout le monde, chez tous les gens que vous rencontrez,
c'est ce qu'ils n'ont pas envie de savoir. Ils croient qu'ils savent tout, ils
ne se posent jamais de questions : ils savent tout, mais alors, ce qui est
intéressant dans n'importe quel dialogue, c'est deviner ce que la personne qui
est là n'a pas envie de savoir. Ça, c'est très intéressant.
Voilà : tendance à penser,
tendance à être honnête, qu'est-ce que ça ne veut pas savoir. Ça s'appelle de
la philosophie pratique (Rires).
Existentialiste même, je dirais.
Le Trou de la Vierge, un film d'une heure tourné en 1982. C'est
toujours avec Fargier.
Ah! Quelle merveille... L’origine du monde, le tableau de Lacan.
L'Origine du monde bien sûr, il en est question. À ce sujet, avez
vous vu Une sale histoire, un film
d'Eustache ?
Ah, les toilettes voyeurs ?
Il faut que vous voyiez ce film. Lonsdale et
Picq racontent la même histoire. Étonnant.
Oui. Je ne l'ai jamais vu, il ne
passe jamais, non ?
En
tous les cas, pas à la télévision après le journal télévisé.
Combien de minutes ?
Ça
doit durer 46 minutes. J'essayerai d'avoir une copie, un DVD ou un lien sur
Internet. Je vous l'enverrai.
Volontiers.
Ce
sont des types qui descendent dans les toilettes d'un bistrot, parce qu'il y a,
en bas de la porte des toilettes pour femmes, un trou. Une histoire de voyeurs
dans un bar qui s'est construite autour d'un trou.
Alors que ce que je fais, c'est le
contraire.
Oui.
Ah!
Le Trou de la Vierge, un entretien d'une heure avec Jacques Henric où il est question, bien sûr, du corps, du corps et
de la voix, du trou par lequel sort le corps. Bien sûr, il est question du
tableau de Courbet qui figure sur la couverture d'Art Press que vous montrez, mais aussi de Freud, de
la jouissance ou de l'absence de jouissance qui se raconte sur le divan ; de la
représentation du corps dans la peinture. Il est question de tout cela. Comment
se fait ce film-là ? Avec Fargier, avec Henric ? Qui en a l'idée ? Comment ça se passe ?
Fargier et Henric sont des amis. C'est le moment où l'on a
fait une couverture d'Art Press je crois, avec une photo de L'Origine du monde. Ça a déclenché des fantasmes partout, comme si
c'était une photo pornographique... Donc, on a fait ce film pour réagir, d'une
certaine façon. Et là je me suis dit, dans une élucubration sur les
assomptions, les ascensions, que je n'explique peut-être pas assez, d'ailleurs,
que Le Trou de la Vierge c'est le
seul corps - vous n'êtes pas obligé d'adopter ces coordonnées de géométrie
fantastique -, topologiquement, c'est le seul corps
qui a été effracté de l'intérieur, et pas de
l'extérieur, donc il n'y a aucune fascination pour ce qui bloque...
Mais maintenant, que se passe-t-il
? Ce tableau est sagement accroché au musée d'Orsay, il n'y a plus personne
pour le voir. C'est la légende qui compte. Pourquoi Lacan convoquait-il les
gens après dîner, il allumait un cigare, il faisait coulisser le tableau de son
beau-frère, l'écartant du même coup. Enfin, tout ça c'est des histoires.
Il a fallu qu'un soir on projette Le Trou de la Vierge au cinéma, là,
juste à côté, et il y avait Cuny dans la salle qui tout d'un coup dit : « Mais
ce tableau est chez Lacan. » De là tout est parti. Il était à Guitrancourt, dans la maison de campagne de Lacan. Et c'est
Sylvia, ex-Bataille, qui a dit : « Il faut le recouvrir d'un autre tableau. »
C'est Masson qui l'a fait, marron-chocolat, parce que la femme de ménage ou les
voisins ne comprendraient pas. Or ce tableau légendaire est désormais tout à
fait invisible. Les Japonais passent devant et ne le photographient pas parce
qu'il y a des poils, et les Américains pareil. Il est devenu invisible ! D'une
tout autre façon qu'en accomplissant son long parcours à travers la Hongrie.
Vous savez ce qui s'est passé, c'est extravagant. Le baron de Hatvany, qui était juif, a mis ce tableau dans des banques
non juives. Adolph Eichmann, qui n'est pas n'importe qui, est arrivé à piller
toutes les banques juives avant que les soviétiques à leur arrivée à leur tour
pillent tout. Et c'est un colonel de l'armée rouge qui s'est laissé corrompre,
et Hatvany a pu racheter son tableau avant qu'il
parte chez Staline qui aurait dit non, mais non, mais ça ne va pas, la tête ! (Rires).
C'est une histoire fabuleuse !
L'histoire de l'humanité. Ah ! Ce qu'on peut faire avec la peinture !
En
1983, c'est Sollers
au pied du mur. Là, comment ça se passe,
l'idée du film ? C'est Fargier qui vous appelle ?
C'est lui qui vous dit qu'il aimerait aller là-bas ?
Eh bien, là nous sommes à
Jérusalem. On établit qu'on va là-bas, tu m'accompagnes, on verra ce qu'on
fait... Voilà, on improvise. On improvise, mais avec quand même une idée
derrière la tête. On lit Itinéraire de
Paris à Jérusalem de Chateaubriand... Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Oui,
Jérusalem. C'est un film que j'aime beaucoup, qui commence, je crois, sur le
parvis, tout près du Saint-Sépulcre. C'est là que vous lisez Paradis, et puis après, Finnegans Wake... Et puis je le trouve drôle, décalé par
moments, notamment la séquence avec la calotte.
Alors, écoutez, c'était très beau
parce que j'avais ma calotte en carton (Rires).
J'avais ma calotte, et en effet je
commence à lire Paradis, et puis j'ai
lu Finnegans Wake aussi, de temps en temps. Alors ce
qui était beau, c'était les femmes qui étaient de l'autre côté, parce qu’elles
n'ont pas le droit d'être là.
Oui,
elles sont filmées, elles semblent être au-dessus de vous, elles vous regardent
lire.
On les voit s'intéresser à ce type
qui lit... Enfin, on m'a laissé faire, c'est tout de même étonnant, parce que
franchement...
On se pose la question, absolument, on se demande comment vous avez fait ?
Putain ! il faut le faire. Aucun mec n'a jamais fait ça, à ma connaissance.
Et alors elles sont là, en train
de regarder... C'est très touchant.
Oui,
des jeunes femmes.
Après, il y avait des soldats
colombiens - je ne sais plus ce qu'ils faisaient là.
Les femmes étaient très attirées
par ce type en train de lire un truc incompréhensible (Rires).
Dans la pure tradition hébraïque,
fondamentale, le Hazan de la synagogue ! Alors avec Finnegans Wake, c'est encore mieux.
C'est
un film qui me touche tout particulièrement.
Ça commence au Mont des Oliviers,
non ?
Oui,
le soleil est derrière, c'est un contre-jour. C'est après que vous allez au
pied du mur.
C'est l'un des meilleurs de Fargier, je crois. Il y a aussi les images de Jéricho.
Ah bien, oui ! Si vous parlez de
lieu, alors... En voilà un. Jéricho est la plus ancienne ville du monde. C'est extraordinaire,
Jéricho !
Il
y a la Mer Morte, une belle séquence à l'endroit où on a trouvé le rouleau
d'Isaïe et où vivaient les Esséniens. Il y a tout ça. Vous êtes assis par
terre. Il y a de très belles images, avec une très belle lumière. Ce que
j'aime, voilà, c'est qu'il y a un lieu, des lieux et une personne, et qu'un
rapport s'établit tout de suite entre ce que l'on entend, entre la voix, entre
vous et le paysage.
Vous connaissez le Diderot, que l'on a fait ensemble ?
Le Diderot, oui, bien sûr, j'y viens.
Jérusalem, c'était une époque de
paix relative. Bizarrement. C'était avant les intifadas.
C'était
1983. Ce n'est pas loin du massacre de Sabra et Chatila,
qui a lieu en 1982.
Oui. Ah ! On va parler de Genet...
Non,
pas tout de suite. Vous participez au montage avec Fargier ?
Assez peu. Au passage, il y a une
monteuse de génie sur le Rodin, c'est
Annie Chevallay. Une femme extraordinaire.
Vous
avez souvent évoqué votre première expérience de montage sur Méditerranée. Qu'en est-il pour votre écriture, sachant que vous écrivez à la main.
Il y a beaucoup de montage, de collage ?
Vous savez, si j'ai le début j'ai
tout, voilà.
Il
y a un plan ?
Jamais !
Jamais
?
Les premières phrases décident de
ce qui va aimanter... Alors je ne sais pas ce qui va se passer. Pour Médium, par exemple, j'ai lu aussi des
enquêtes. Bon, les meilleures enquêtes sont, en général, anglaises, elles sont
britanniques. Par exemple, sur le massacre de Katyn, qui a été menti pendant 50
ans dans toutes les chancelleries, puisqu'il s'agissait des Allemands et pas
des Russes. Alors que ce sont les Russes qui ont exécuté toute l'intelligentsia
polonaise. Je ne vous apprends rien... Si ? Avec une balle dans la nuque. Il a fallu
beaucoup de vodka. Donc ce sont les britanniques qui ont retrouvé Blokhin. Remarquez, le bourreau Sanson, place de la
Concorde, n'en pouvait plus non plus. Vous comprenez, c'est ça qui m'intéresse,
ce sont les massacres ponctuels et très précis. Des massacres, vous en avez
tout le temps.
Du point de vue cinématographique, Lanzmann est indépassable. Je lui ai rendu hommage 10
000 fois. Bon voilà, c'est tout, parce que justement il ne montre pas. Ça,
c'est très fort. Sobibor, 14 octobre
1943, 16 heures. C'est vraiment du très grand cinéma ! Du cinéma comme il
n'y en a pas. Bon. Donc, le montage est essentiel. Le mixage.
Et
dans votre écriture.
(Un clocher se met à sonner en arrière-plan.)
Alors je crée une zone d'aimantation.
Elle est là. Et ça arrive. Exemple : je lis une enquête britannique sur le
trafic de cadavres, puis, tout d'un coup, j'ai dans l'idée, tiens je vais
écrire... Voilà, ça vient. Je trouve que le monde est fou, hein, voilà. Il
l'est véritablement, selon moi. Ce serait à notre tour d'être fou que de croire
que l'on n'est pas fou, dit Pascal, mais je vais rectifier, je vais reprendre
directement Pascal. Bon, voilà. Et je vais le prouver. Je suis frappé que les
écrivains soient si légers avec leur époque. Ça s'appelle l'envers de
l'histoire contemporaine, à partir d'un tableau d'aimantation.
L'envers de l'histoire
contemporaine, ce sont des choses ahurissantes ! Parce que je lis, par exemple,
ça au public, et personne n'a l'air de le trouver préoccupant. Et ça vaut pour
moi comme validation, de voir la stupeur qui n'entend peut-être même pas que je
raconte des énormités qui sont parfaitement prouvables.
Je m'étonne que, s'agissant de la
reproduction des corps, de la prise en main par la technique des substances
reproductives, il ne se dise rien.
Écoutez, j'aurai dû le mettre dans Médium, mais c'est venu trop tard. Il
y a quelques jours, je vois une fille noire sublime, très jolie, née au
Burkina-Faso, passer chez Elkabbach, à la télévision, et qui a écrit un livre
sur l'excision. Je vais le commander pour le lire attentivement. Elle raconte
qu'elle a été excisée à l'âge de cinq ans. Ce sont les femmes qui s'occupent de
ça, de mère en fille et de fil en aiguille. Elle dit qu'il y a 130 millions de
femmes excisées sur la planète. Tout cela se passe en Afrique. Elle vit en
Belgique. Il y a 3 000 excisions en Belgique. En banlieue je ne vous dis pas !
C'est interdit par la loi, seulement si tout le monde se tait... OK. C'est
quand même une mutilation extrêmement gravissime ! Ou alors c'est qu'on n'est
jamais allé sur le terrain pour savoir comment les femmes jouissent ou pas, ou
si elles sont simplement bonnes à être bourrées et à faire des enfants, OK ! Je
m'étonne que ce soit si peu présent dans la littérature mondiale.
Ça m'étonne, voyez-vous. Ça
m'étonne.
Je suis un écrivain, donc vous
voyez, très engagé. Tout le reste, vous savez, c'est du bla-bla.
Pardonnez-moi,
mais je reviens un instant sur Lanzmann. Et peut-être
que cela a à voir avec ce que vous venez de dire. Il y a quelque chose qui
m'intéresse, par rapport au lieu et par rapport à l'image. C'est le c'était
ici, plus que le c'était ainsi, ou le ça a été de Barthes. Là, je parle de Shoah.
Oui.
Il
y a une séquence dans Shoah, d'un homme accompagné de la
caméra qui marche dans un sous-bois et qui arrive dans une clairière, et il dit
: « C'était là. » La clairière est éclairée, c'est le printemps, je crois qu'il
fait beau, un couple déjeune sur l'herbe, les enfants sont en train de jouer au
ballon, et l'horreur était là. Et là, ce que l'on voit c'est la prairie. C'est
le calme et la paix. Vous rendez-vous compte, ces deux mots : « C'était là. »
L'importance qu'ils prennent. Leur résonnance sur l'image. C'est aussi fort que
des violons pour dramatiser l'image. Ce n'est pas comparable, mais c'est comme
ça que j'ai vu Mettray. Il n'y avait plus rien, mais
c'était ici. C'est le besoin des mots sur des images. Non ? C'est l'image qui
est tout de suite du passé.
Nous marchons sur les morts,
Morin. Vous entrez dans n'importe quelle église de Venise, vous marchez sur des
dalles de gens qui sont là. Vous allez à Santa Maria dei Fiori, je vous assure
que comme lieu, ça vaut le coup de faire un petit détour ; vous avez la tombe
de Monteverdi, avec toujours une fleur d'anonyme, et une partition de musique.
Venise a fait ce que n'a fait aucune autre civilisation. Il n'y a pas un
musicien au Panthéon. Voilà, la France est sourde ! Mais vous marchez sur les
morts.
Alors, Sollers joue Diderot !
C'est encore avec Fargier, et c'est avec Élisabeth Barillé.
Oh oui, une très belle amie de
l'époque.
Alors, Sollers joue Diderot, oui. Très drôle, magnifique. Là encore, un
lieu et vous. Donc on reprend une forme, on reprend la forme sur Sollers au
pied du mur : un lieu et un personnage. Et
ça, c'est au Palais Royal.
Jack Lang me regardait ahuri
depuis son bureau. (Rires.)
On
sort du temps pour rentrer dans un autre temps. On est constamment là-dedans.
Alors, la Lettre sur
les aveugles. Vous dites : « L'expérience
de la pensée doit aussi passer par le sommeil, les yeux fermés. »
C'est pour cela qu'il a fait de la
prison.
Alors
là, on est dans votre siècle, enfin, celui que vous préférez : le XVIIIe,
les Lumières. Le
Neveu de Rameau... Vous questionnez les
gens s'ils connaissent, s'ils ont lu Diderot.
Oui, sur le boulevard ou dans les
stations de métro, oui, voilà. Les Français ne seraient pas en si mauvais état
s'ils avaient le réflexe élémentaire de se souvenir qu'à ce moment-là, ils employaient
une langue qui était parlée par l'Europe entière. Voltaire ! Mon camarade.
Et
là, c'est aussi improvisé ? Il n'y a pas un semblant de scénario ?
Tout ça, ce sont des
improvisations. Pour le Rodin, j'ai
fait quelques petits dessins.
Pour
le Diderot ?
Pour le Diderot, c'est venu comme ça. Il y avait ces deux filles... voilà.
Je lis, je ferme les yeux, c'était
plutôt bien, facile. Je ne comprends pas ce qu'il peut y avoir de difficile à
écrire ou à s'exprimer. C'est ce que j'appelle le catéchisme de Flaubert, qui
est révéré comme s'il y avait un mérite particulier... C'est pour ça que l'université
ne peut pas considérer que j'existe, vous comprenez.
Mais non, bien sûr...
C'est
tant mieux, j'allais dire : non...
C'est tant mieux, oui, oui. Ça
leur paraît facile. Ils croient que c'est superficiel. Comme dit Lichtenberg,
quand un livre et une tête se rencontrent et que ça sonne creux, ce n'est pas
forcément la faute du livre (Rires).
(Rires) Oui, je sais... Debord, pour parler de l'université, disait : «
Connaissances avariées ».
La phrase de Debord la plus convaincante, c'est au sujet des journalistes médiatiques, « Les
salariés surmenés du vide. » (Rires).
Ah!
Alors,
le dernier film avec Fargier, c'est en 1988, Picasso by night by Sollers, à partir d'une conférence que vous
prononcez en 1986. C'est donc un événement qui est filmé, un événement de
parole. Je sais que Picasso compte pour vous autant que Céline et Joyce, qui
sont, selon vous, les trois grands artistes du XXe siècle. Ce qui
vous intéresse notamment dans l'œuvre de Picasso, c'est qu'il a fait évoluer la
représentation féminine dans la peinture.
Oui, fabuleusement.
Vous
souvenez-vous de ce film, de cette conférence ?
Oui, oui, très bien. C'était à
Beaubourg, je crois. J'avais jeté un froid, est-ce que c'était à partir d'une
question ?... Mais je me rappelle du froid que j'ai jeté en prétendant que Picasso
n'avait pas d'âme. Que tout était physique, chez lui, sans âme. Ça avait refroidi les spectatrices... et
j'avais aussi fait entendre Picasso en espagnol.
J'ai du reste fait un petit film
supplémentaire avec L'Allinec, Les Demoiselles d'Avignon, avec comme musique Stravinski et La Niña de Los Peines, dont je vous ai déjà
parlé à propos de Méditerranée.
Donc, il faut entendre et voir
Picasso en espagnol. D'où l'enregistrement à toute allure qui est conservé au
musée Picasso sûrement, de la lecture des textes non ponctués de Picasso. Ça me
convient parfaitement. C'est très étonnant, il faut le lire à toute allure.
Voilà. En espagnol.
Hum,
hum...
Je peux le faire, j'ai pu le
faire. C'est très difficile à faire, parce que ça dure quand même trois quarts
d'heure.
Oui,
je l'ai vu, et entendu.
Alors, c'est très intéressant
parce que, vous connaissez le mot de Picasso : « La ponctuation est faite pour
cacher les parties honteuses de la littérature », donc au moment où il a eu des
difficultés pour peindre, il s'est mis à faire ça, pendant... je ne sais pas...
dans les années 1930, 1931. Sa vie n'allait pas, sa peinture ne marchait pas,
il a fait à très haute dose ce genre de textes qui ne sont ni de la poésie, ni
de la littérature au sens classique du mot. C'est plutôt un dégorgement de mots,
mais il a eu besoin de faire ça. Et il l'a fait.
Oui.
Donc, ce qui m'intéresse chez
Picasso, c'est ça ; d'une part, la verbalisation constante dans laquelle il se
trouvait et qu'il a prouvé en écrivant ces textes, très étranges quand même ; deuxièmement,
le concept fondamental pour lui, c'est ce qu'il a appelé lui-même, l'omnispection, pour ce qui est de la représentation, c'est
très important, ça consiste à voir de tous les côtés à la fois : de face, de
dos, etc. C'est-à-dire, d'avoir un corps capable de voir de partout à la fois.
Et ça, ça change tout. Parce que la plupart des représentations se présentent
en effet de façon frontale. Je ne vous parle pas de ce que fait maintenant
l'image virtuelle qui essaye d'être partout et nulle part en même temps, pour
finalement rien, c'est-à-dire dans la dissolution de l'image. Ça devait lui arriver
à l'image, n'est-ce pas. Mais Picasso se signalant là, à la grande, grande
époque, là où il a dit : « on aurait dû s'en tenir là », c'est évidemment
pour moi la période dite du cubisme synthétique, c'est-à-dire les papiers
collés qui sont d'une beauté absolument souveraine. Donc 1912-1915, par là,
c'est là que l'on est dans un ravissement, à mon avis, total.
J'ai
souvenir d'une exposition à Beaubourg, il y a une vingtaine d'années, Le Dernier Picasso, une exposition sur sa dernière période,
donc des œuvres tardives, celles de la fin de sa vie.
Le dernier Picasso, vous l'avez
dans Picasso le héros, qui est là
derrière vous, livre qui doit être un peu épuisé, avec beaucoup de tableaux peu
connus.
Vous
l'avez rencontré, Picasso ?
Non. J'aurai dû, mais enfin...
Vous
parlez beaucoup du corps de Picasso, vous dites qu'il aimait se mettre torse
nu.
Ça a été un des premiers à se
montrer torse nu, et surtout le fameux torse nu à Moscou, après le discours de Radek. Il n'en pouvait plus, c'était l'attaque stalinienne
contre Joyce et Picasso, donc il n'en pouvait plus, et il s'est mis torse nu sans
rien dire. Voilà. Un geste fou.
Et puis, les fameuses photos dans
son atelier en 1915, habillé, puis torse nu, et ce qu'il faut regarder, c'est
pourquoi il a fait ça, avec ses œuvres accrochées au mur. Parfois des guitares
préparées, etc. Tout cela en musique. Ecce
homo, c'est-à-dire, voilà mon corps. Ça, évidemment, Braque n'aurait jamais
pu le faire, ni d'ailleurs aucun autre artiste. Le défi tauromachique à
l'appareil. « J'ai compris la photographie, je peux mourir. » Attention, ça va
très loin. La photo, c'est la mort. C'est traverser la mort. Et ça, c'est très
étonnant. C'est une sorte de métaphysique avec son corps. Voilà.
À
Vauvenargues, au pied de la montagne Sainte-Victoire, dans son château, il lui
arrivait souvent de recevoir ses amis dans sa vaste salle de bain, lui étant
dans sa baignoire. On imagine la scène.
Je vous disais que Genet est pour
moi un écrivain aristocratique, et un écrivain du Royaume. Même chose évidente
chez Picasso, c'est-à-dire les châteaux, l'aspect absolument royal de sa
personnalité. Mais ça ne se décide pas. Qu'il ait été communiste est une des
choses les plus comiques de l'histoire. Mais on sait pourquoi, on lui a refusé
la nationalité française en 1940. Dangereux anarchiste. Mais il a toujours rêvé
de vivre dans... oui, oui, à la Louis XIV, à la mousquetaire, le peintre des
mousquetaires. Il adorait ça.
Puis,
de se faire enterrer comme cela, juste au pied de la Sainte-Victoire... Quel
hommage à Cézanne aussi.
Oui, voilà, ce sont les rois. Les
rois, les vrais. Les autres sont faux.
Vous
évoquiez tout à l'heure le film réalisé avec Laurène L'Allinec, Les Demoiselles
d'Avignon, en 1988. Puis viennent après
celui-ci deux autres, La Porte de l'Enfer en 1991 et Interlocution en
2005, avec Dominique Rolin.
Absolument. C'est filmé dans son
appartement.
Le
film commence ainsi. Vous entrez dans le cadre et vous dites d'une voix un peu
forte : « C'est beau le cinéma...tographe. » (Rires
de Philippe Sollers). Avec Laurène L'Allinec, est-ce
que c'est comme avec Fargier ? C'est-à-dire, est-ce
que les projets de films naissent comme ça dans une discussion, ou rien n'a
vraiment été décidé auparavant ? Ça se passe ainsi ?
Exactement. C'est l'amitié qui
débouche sur un intérêt ponctuel, commun, comme dans le film avec Dominique
Rolin, c'est une improvisation avec de la musique que j'envoie de temps en
temps. Ou une récitation de La Fontaine.
Je
fais un flash-back un instant sur La Porte de l'Enfer.
Vous ne m'avez rien dit sur La Porte du Paradis à Florence ?
Qui m'a beaucoup impressionné. Mon
premier voyage en Italie, très tôt, où je reste assez longtemps à Florence. La
Porte du Paradis de Ghiberti, et surtout le Baptistère de Saint-Jean, où Dante
a été baptisé. Il y avait une inscription d'ailleurs, du Pape Paul VI. Bien
qu'il ait dit beaucoup de mal des papes, Dante a fini par être considéré comme
canonique. Et c'est Benoît XV qui a écrit cet éloge sur Dante que j'ai publié
dans L'Infini. Un fameux texte pas
assez connu.
Benoît XV, le Pape qui s'est fait
traiter de tout parce qu'il a dit aux Français et aux Allemands de la Guerre de
1914, si vous continuez comme ça vous allez produire un événement effrayant en
Europe... Ce qui a eu lieu, puisque Hitler est venu dans la foulée, et en 1917
il y avait déjà Monsieur Staline dans ses œuvres, ou un peu plus tard.
Mais enfin, Benoît XV oui, c'est
un Pape méconnu. Il meurt de chagrin en 1921, parce que l'Europe ruisselait de
sang. Alors il se faisait traiter de pape boche par les Français, et de traître
par les Allemands. Alors qu'il était la raison même. Je me demande toujours
pourquoi on célèbre la guerre de 1914-1918.
Il y avait un Anglais l'autre jour
avec qui je discutais qui me dit : « ah oui, il y a une polémique maintenant en
Angleterre sur le fait : cette guerre était-elle nécessaire ? » Et en effet,
personne ne m'a jamais expliqué pourquoi cette guerre était nécessaire, parce
que le reste s'en suit, ce n'est pas la peine d'insister.
Cette boucherie était-elle
nécessaire ? Pourquoi ? Je n'ai jamais trouvé quelqu'un pour me
l'expliquer. Il faut se mettre au garde-à-vous, saluer, commémorer l'héroïsme
des Poilus, etc.
Les
fusillés pour l'exemple...
Ça me fait vomir.
Allez,
revenons à Interlocution et à Dominique Rolin. Il y est question de
musique, on vous voit mettre de la musique, des CD, il y est question de
poésie, de La Fontaine, d'un « T », de la lettre T. Vous lui lisez quelques
vers.
« Tenez-vous lieu de tout, comptez
pour rien le reste », alors ça c'est Les
deux Pigeons s'aimaient d'amour tendre, c'est là. Oui. (Philippe Sollers cherche dans sa mémoire)
«... voulez-vous voyager ? Que ce soit aux rives prochaines ; soyez-vous l'un à
l'autre un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau ; Tenez-vous
lieu de tout, comptez pour rien le reste. » Voilà.
Ça c'est, lorsque l'on écoute un
peu, en effet, « T ».
Le
« T », oui. Et donc là, il est question de musique, parce qu'à un moment, je
crois, c'est Gould que vous lui...
Oui, c'est Gould qui joue du
Haydn.
Mozart,
qui appelait Haydn Papa.
À qui il a dédié ses quatuors.
Parce qu'on ne peut pas faire mieux comme quatuors que Haydn. On a demandé à
Haydn lorsqu'il était à Londres, très chagriné d'apprendre la mort de Mozart,
s'il écrirait un quintette. Il a dit non, le quintette je ne touche pas, c'est
Mozart, hein, attention. Quintette avec clarinette... les quintettes de Mozart
sont admirables, là il faut un instrument de plus. C'est là où l'alto devient
quelque chose d'autre que dans le quatuor.
L'amitié entre Haydn et Mozart est
une chose tout à fait extraordinaire. C'est très peu courant. Très peu. Grande
admiration réciproque. Haydn est présent un matin chez Mozart, à dix heures,
lorsque Mozart va faire répéter Cosi fan tutte. Il
l'a reconnu, Haydn a dit tout de suite au père de Mozart, vous avez à faire à
quelqu'un d'absolument exceptionnel. Donc amitié, admiration réciproque,
rarissime.
Et
là, il est question de ce que l'on entend avec Dominique Rolin.
C'est-à-dire de l'amour.
C'est-à-dire
de l'amour.
Tout simplement !
On sait qu'on aime quelqu'un si on
peut écouter assez longtemps ensemble la même musique. Il y a deux critères :
c'est la marche dans la rue avec quelqu'un - c'est elle qui me disait cela,
très justement d'ailleurs - on se prend par le bras, et on marche. Et le fait
de passer une heure ou deux à écouter de la musique en se taisant, forcément,
parce qu'on ne parle pas pendant qu'il y a de la musique. Voilà. Et puis le
reste, ça veut dire que chacun travaille de son côté.
Oui,
bien sûr. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment ? De la voix ? De l'instrument
?
Bien, j'ai tendance à écouter
toujours la même chose, c'est restreint vraiment. Mais j'écoute de
l'instrument. J'en écoute moins parce que j'ai moins de partenaires pour me
taire en écoutant de la musique. Il faut être plutôt deux, pour que la musique
résonne, comme elle doit résonner. Il faut quatre oreilles si vous voulez.
Vous
jouez du piano ?
Oui, vaguement, je pianote. Mais
pas vraiment. Je peux vous imiter Blue
Monk, par exemple.
C'est
vrai, je ne vous ai jamais entendu parler de jazz.
Très important. J'ai une
collection tout ébréchée, là, dans un coin, à la campagne, de 78 tours que
j'achetais à l'époque. Ça a été pour moi une révélation fulgurante. Ah oui ! La
venue de Louis Armstrong, j'ai douze ans ou treize ans, à Bordeaux, a été pour
moi un éblouissement. Je voulais jouer de la clarinette, mais mes parents ne
m'ont pas offert de clarinette - tant mieux, parce que là, je jouerais très mal
de la clarinette, mais peu importe... J'écoutais aussi Mezz Mezzrow, Really the blues,
oui. Là, j'ai une collection de disques tout à fait impressionnante. Voilà,
surtout les Armstrong, Ella Fitzgerald, Charlie Parker. Et Monk, bien sûr.
Plus
tard Coltrane ?
Je n'aime pas beaucoup le saxo. Je
sais que beaucoup de choses se passent là. Non. C'est le piano renversé, de
telle sorte que le piano n'est plus le piano. Ou alors, Lennie Tristano, par exemple. Ou ce géant ! Qui s'appelle Thelonious, Sphere - deuxième
prénom - Monk. Ses parents lui ont donné un deuxième prénom qui s'appelle « Sphere ».
Il y a des témoins qui racontent
que Mozart jouait du piano quand il arrivait, il improvisait, il écrivait au
dernier moment, ce n'était plus du piano, c'était autre chose. Les instrumentistes
qui arrivent à dépasser complètement l'instrument pour être dans leur propre
monde, c'est rare. Monk ou Gould, dont vous connaissez les enregistrements
visuels, la mâchoire jouant du clavier, le fredonnement qui gênait les
enregistreurs. Il n'y en a qu'un autre qui fait ça, c'est Pablo Casals -
admirable instrumentiste, où le violoncelle devient tout à fait autre chose.
Les Suites de Bach par exemple. Extraordinaire ! Dépassement de l'instrument.
Pareil pour la voix, chez Bartoli, chez Billie Holiday ou chez Ella Fitzgerald.
Revenons,
si vous voulez, à vos films, les derniers, ceux réalisés avec G.K. Galabov et Sophie Zhang.
Oui.
Il
y a le film Vers le
Paradis (DVD Desclée de Brouwer, 2010), suivi d’une conférence que vous prononcez aux Bernardins en
2009. Il y a La Révolution Catholique,
en 2010. Il y a Les Voyageurs du Temps, L’Éclaircie et Médium. Sur ces cinq films, trois reprennent le
titre de trois de vos romans, à savoir Médium, L’Éclaircie et Les Voyageurs du Temps.
Oui, comme je vous le disais tout
à l'heure, ce sont des prolongements.
Vous les pensez comme ça, vous les réalisez comme ça ?
Oui, absolument. Le dernier, c'est
pour faire rentrer Venise dans Versailles, et Versailles dans Venise. Comment
faire ? Ça se fait de façon musicale. Tout d'un coup, en haut des escaliers de
Versailles, qui sont sublimes, apparaît Bartoli. Après ça, il y a les bateaux,
je ne sais pas quoi à la fin...
Cecilia
Bartoli apparaît aussi dans La Révolution Catholique...
C'est un amour. C'est un génie !
Maintenant elle a 48 ans, elle va chanter Rossini, c'est plus facile. C'est une
très grande mezzo. Très cultivée ! Déchiffrant les partitions inconnues, etc.
C'est une fille absolument géniale.
Elle peut tout faire : elle peut aller
très bas, elle peut crier très haut. Elle a elle-même fait enregistrer ses
cordes vocales. Elle a travaillé sur l'image qu'elle recevait de ses cordes
vocales. Donc elle se considère comme un instrument de ses cordes vocales.
Voilà.
C'est le contraire du concert
romantique ! On n'est pas en avant de l'orchestre. L'orchestre n'est pas là
pour que la diva règne... Elle est avec son orchestre, exactement... Si vous
voyez des images d'elle, elle lance son orchestre comme un musicien de jazz,
justement... elle tape du pied et hop ! C'est parti. Elle est à l'intérieur
comme un instrument, parmi d'autres instruments.
Et
la Callas, c'est une voix que vous avez ou que vous écoutez ?
J'ai horreur de ça.
Ah
bon ?
Ah oui, je déteste ça. Ce n'est
pas grave.
Ah
bon, ce n'est pas grave... Puis comme opéra que vous avez utilisé, il y a Don Giovanni dans La Révolution Catholique,
que vous réalisez en 2010. L'attentat contre le Pape Jean-Paul II, Pape qui a
joué un rôle très important dans la chute de l'URSS.
Très important. J'ai raconté
souvent que j'étais à New York à l'époque, à l'Université de New York dans le
département, comment on dit... French and Italian. Il
faut être américain pour mettre dans le même sac le français et l'italien. Et
donc je téléphone à Julia à Paris, qui me dit : « Il vient de se passer un truc
étonnant : il y a un polonais qui vient d'être élu Pape. » Je me tourne vers le
chairman - un honorable correspondant de la CIA bien sûr, qui surveillait tout
ça -, et je lui dis, « ah ! Il vient de se passer quelque chose
d'étonnant, il y a l'élection d'un Pape polonais. Il me regarde comme ça, et il
me dit : « So what ? So what ? » Et il y avait d'autres rapports
de force.
Solidarnosc.
Oui, la Pologne... Jean-Paul II
avait vingt ans au moment du pacte stalinien-nazi. C'est un saint, maintenant,
qui m'a béni à Rome lorsque je lui offre mon livre sur la Divine Comédie de Dante. Il faut perdre l'habitude de dire «
pacte germano-soviétique ». Il faut l'appeler par son nom : le pacte
stalino-nazi.
J'étais
en Pologne, l'été 1982, j'ai photographié à Czestochowa des événements très
violents, la police frappant des vieilles femmes qui vendaient des badges du Pape.
Czestochowa est ce lieu de pèlerinage - l'équivalent de Lourdes.
La Vierge noire. Le Trou de la Vierge noire ! (Rires)
(Rires). C'est un autre film.
Oui. En hommage à DSK (Rires).
Oui,
c'est ça (Rires).
Et Médium est votre dernier roman, paru cet hiver – et votre dernier film
où, là encore, le montage son, la musique occupent une place importante.
Dans le montage son, on s'aperçoit
qu'il y a quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Avec Cecilia Bartoli
dans Médium, ou Ella Fitzgerald, ou La Niña de los Peines, j'introduis, je pense, quelque
chose comme de la vraie présence musicale dans le cinéma. La pénibilité du
cinéma, c'est-à-dire de sa bande son, ou alors le seul qui essaye de se
rapprocher de ça, parce qu'on sent que ça le travaille, la peinture, la
musique, c'est Godard bien sûr. Mais, là musique... voilà, il reste quand même
protestant. Donc il a une sorte de puritanisme profond. Ce que je fais, c'est
au contraire une explosion baroque.
Si vous avez vu Médium, il commence par cette séquence
absolument cocasse, mais c'est formidable : c'est le God save the Queen.
Et la reine est parfaite, en trois minutes, dans sa petite robe jaune.
 |
|
Philippe Sollers Médium - un film de G. K. Galabov et Sophie Zhang
|
| |
Alors
que dans votre roman, il y a Loretta, la serveuse du restaurant où vous dînez,
et puis Ada, la masseuse...
Le massage tarifé qui devient
gratuit... Bon, c'est-à-dire quelque chose qui se produit et qui est à mon avis
intéressant, parce que si ce n'est pas gratuit, il ne se passe rien.
Et
puis il y a les enquêtes, et le « manuel de contre-folie ».
Et puis il y a la Chine, qui
arrive à un moment donné. C'est la radio... J'invente une radio qui émet des
messages qui doivent être captés et compris sur une certaine longueur d'ondes,
courtes ou ultra-courtes.
Ce sont toujours mes souvenirs
d'enfance, de la radio anglaise : « Ici Londres, les Français parlent aux
Français ». Alors là, j'imagine : les Chinois parlent aux Français, ou les
Français chinois parlent aux Chinois... « Voici quelques messages personnels ».
C'est pour cela qu'il y a la reine d'Angleterre au départ de Médium.
Et
une société déliquescente.
Qui n'est plus rien. Je ne sais
pas, moi, vous en avez cent preuves par jour. Je crois qu'il n'y a plus rien à
attendre d'aucune façon de la so-cié-té.
Cependant, dirait Cézanne, la nature est très belle. Dieu étant devenu société,
Dieu est mort, mais la société n'arrête pas de mourir, de s'entretenir de sa
mort. Donc tout ce qui est social doit être, à plat, calmement critiqué.
Il
y a de plus en plus de livres, il y a de moins en moins de littérature ? C'est
aussi à cause des éditeurs qui publient n'importe quoi, non ?
Oui.
Il
y a de plus en plus d'artistes et de moins en moins d'art ? Là c'est le
problème des galeries, des musées, des critiques, absence de critiques ?
Voilà. « Beaucoup de choses se
passent, peu de choses est à l'œuvre. » (Heidegger)
Beaucoup
de communication.
Sans arrêt. Le problème est de
savoir si on tient debout dedans. On peut très bien utiliser la communication,
la technique. Ça m'est beaucoup reproché.
Oui, ça m'est reproché, bien sûr,
mais de façon, je dirais, archaïque ou arriérée. C'est-à-dire, il faut être
suffisamment schizophrène pour utiliser son corps dans toutes les positions
possibles pour avancer, et rester libre. Ça, c'est ma critique de Debord... C'est-à-dire, il ne faut pas aller s'isoler en
Auvergne - pourquoi pas... Il faut rester comme un poisson dans l'eau. Ça
demande un système nerveux un peu particulier, mais après tout c'est faisable.
C'est faisable ! Je l'ai prouvé, comme ça, je peux faire exactement ce que je
veux, écrire exactement ce que je veux, sans aucun regard porté sur ce que je
suis en train de vouloir faire. Ça ne demande pas des moyens considérables, même financiers.
Dans
le livre d'entretiens, Les grands entretiens d’Art Press - que les étudiants et professeurs des
écoles des Beaux-Arts devraient lire - qui vient de paraître chez IMEC et Art Press, vous vous définissez comme anarchiste.
Oui. Je ne crois pas à la société
(Rires). Alors bien entendu, il ne
faut pas le crier sur les toits. C'est là où mes maîtres jésuites resurgissent.
La casuistique ! Balthazar Gracián. C'est l'auteur qu'il faut méditer et
relire, magnifique. En exergue des mémoires, là : « Vite et bien, deux fois
bien. » Ça, c'est magnifique.
Pour
terminer cet entretien, j'aimerais que l'on parle de Genet.
Vous
l'avez rencontré, vous l'avez invité à Tel Quel, rue de Rennes
?
Oui.
C'était
pour parler des Palestiniens ?
Oui, on s'est vus assez souvent,
soit chez Paule Thévenin, où vous pouviez voir des
gens très particuliers quand même : Michel Leiris, Jean Genet, etc.
La séance rue de Rennes, c'était
au moment du Septembre noir. C'était en présence de Mahmoud Hamchari qui était le représentant de la Palestine en France, qui n'a pas été tué au
revolver, mais qui en décrochant son téléphone a explosé : attentat
professionnel. Et, je le revois, c'était un type très sympathique, et on a fait
le tour de la mosquée de Paris, parce que le recteur ne voulait pas laisser
entrer le cercueil. Alors, on a tourné autour de la mosquée de Paris. Genet
était, bien entendu, très impliqué, déjà. Ça n'allait pas de soi du tout. La
preuve. Ça, c'était un assassinat en plein Paris.
Mais j'aimerais bien mettre les choses au
point. Genet est pour moi - je l'ai un peu connu - le
type même de l'aristocrate spontané. Donc pas d'erreur là-dessus. C'est tout le
fond retourné de l'aristocratie française qui a parlé à travers Genet. C'est ça
qui est très intéressant. À travers son nom même : la nature, les marches...
enfin, j'ai écrit là-dessus : Physique de
Genet ! C'est un écrivain du royaume, c'est-à-dire quelque chose qui
dépasse de très loin toutes les catégories ultérieures, bourgeoises et petite-
bourgeoises.... Vous savez que la France a été un royaume, puis est devenue une
grande nation, comme l'appelaient les Allemands du temps de Napoléon, puis
ensuite une nation, et maintenant c'est une municipalité. Donc Genet, je l'ai
toujours envisagé comme ça, comme quelqu'un qui essaye de retrouver des lieux
où il peut vivre ou respirer dans son aristocratie native. Un Captif amoureux n'est rien d'autre que ça. Et il faudrait aussi
relire tous ses livres. C'est un aristocrate.
C'était
un homme de goût ? Érudit, même ?
J'ai publié des textes de lui
comme son Rembrandt. Un goût tout à
fait étonnant.
Proust, bien sûr, illumination !
Et Proust qu'est-ce que c'est d'autre, sinon un désir fou de rentrer dans
Saint-Simon, c'est-à-dire au sommet de ce qu'il peut y avoir de plus élevé dans
l'art d'écrire, du royaume. Je crois que c'est très simple. Toute autre interprétation
m'a toujours paru réactionnaire.
Dans Un Captif amoureux, les collines du Morvan, où il a passé son
enfance dans cette famille d'accueil qui lui réapparaissent en Jordanie...
Imaginez-vous ce qu'ont pu être
les marches de Genet à travers l'Europe. C'est exactement du même ordre que
celles de Rimbaud qu'on a peine à imaginer. Mais enfin, voilà des gens qui
marchaient. Très souvent, et longtemps.
Philippe Sollers
Entretien réalisé le 2 et 3 avril 2014 dans le bureau
de Philippe Sollers aux éditions Gallimard.
Propos recueillis par Didier Morin, Mettray, septembre 2014
L’INFINI n°129, Automne 2014
|