|
Féerie de
Shakespeare
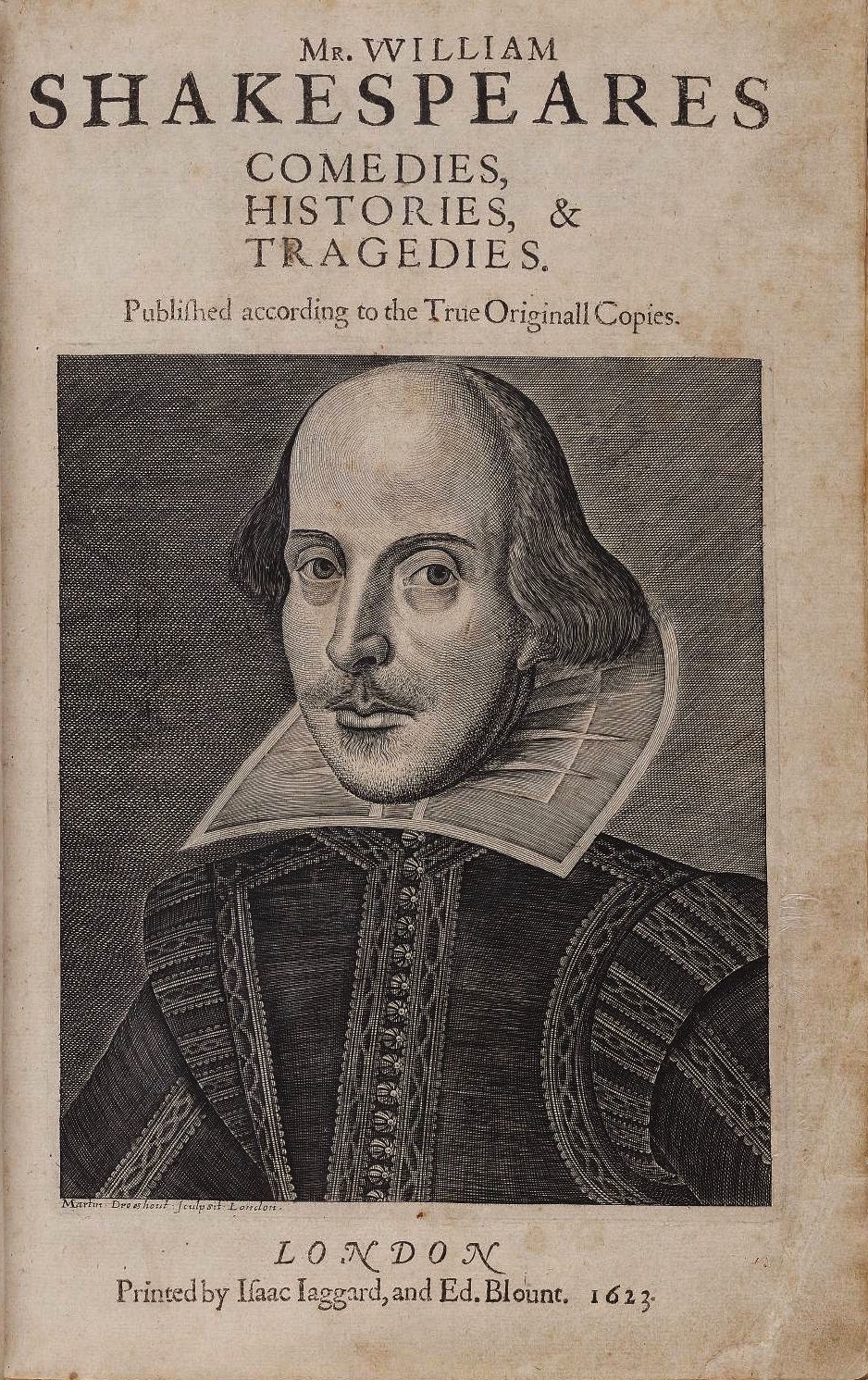
Merveilleuse Pléiade : à gauche, le
texte anglais de Shakespeare, à droite la traduction française. Vous entendez
la musique d'une oreille, vous la déchiffrez de l'autre. Vous êtes au Théâtre
du Globe, sur une autre planète. Les tragédies vous empoignent, les comédies
vous tournent la tête. Shakespeare est comme Dieu : il fait ce qu'il veut.
Reste le problème des traductions, même
si la plupart sont excellentes. Shakespeare accumule les répétitions, les
allusions, les jeux de mots sexuels, les roulements de rythmes, les
travestissements, les troubles d'identité, les équivoques. Fallait-il
transformer La Mégère apprivoisée en Le Dressage de la rebelle ? « Mégère » est très péjoratif pour une
jeune fille à marier, d'accord, mais « dressage » est trop animal. Cette Katherina, au caractère insupportable, deviendra moins
mégère que les autres, douces et sensibles, et c'est la surprise de la pièce.
Nous sommes en Italie (comme souvent chez Shakespeare), et cette « chatte
sauvage » est une furie. Elle contredit tout le monde, à commencer par son
père. C'est l'esprit de vengeance personnifié. Elle déteste les hommes, mais en
voici un qui, par intérêt, relève le défi, et se montre plus fort qu'elle pour
la réduire et la séduire. Il va dire le contraire de tout ce qu'elle dit. Elle
voit le soleil, il voit la lune. Elle trouve qu'il fait chaud, il répond qu'il
gèle, et ainsi de suite, négation de la négation. Inutile de préciser que cette
démonstration délirante et drôle est d'une misogynie scandaleuse. Ailleurs,
dans Peines d'amour perdues, les
femmes prennent leur revanche : « Les langues des filles moqueuses sont aussi
effilées que le tranchant invisible du rasoir. » Ecoutez cette princesse : « Il
n'est de meilleur jeu que de se jouer du jeu des autres, en retournant leurs
tours contre eux. » La guerre des sexes et la comédie des erreurs ne
connaissent pas de trêve.
 |
| Rubens, Vénus et Adonis, 1635 |
Shakespeare n'est pas comique comme le
sera Molière (insurpassable sur ce point), mais divinement fou. Féerie noire (Macbeth). Féerie blanche (Le Songe d'une nuit d'été). Un homme qui
tient le coup face à l'acrimonie féminine, ça ne se rencontre pas tous les
jours, mais c'est encore plus impressionnant s'il s'agit de la reine des fées, Titania, elle «dont l'été est l'empire ». Obéron, le roi, pour se venger d'elle, lui fait administrer
une drogue qui va perturber sa vue au point de la rendre éperdument amoureuse
d'un homme transformé en âne, Bottom (on retrouve
étrangement ce « Bottom » chez Rimbaud). Samuel Pepys écrit bêtement, en 1662 :
« C'est la pièce la plus insipide et ridicule qu'il m'a été donné de voir dans
ma vie. » Pauvre Pepys, débordé par la fantaisie des fées qui traversent les
collines, les vallons, les ronces, les buissons, les parcs, les enclos, les
flammes, les flots et dont les noms sont Fleur de Pois, Toile d'Araignée,
Phalène, Grain de Moutarde ! Pauvre spectateur, ahuri par Puck, qui peut «
enrouler une ceinture autour de la Terre en quarante minutes » ! Comment
résister à la sublime musique de Purcell, The Fairy Queen ? Une reine
amoureuse d'un âne! Quel tableau! Mais la musique est là pour « ensorceler le
sommeil ».
Tout est musique chez Shakespeare, et
c'est d'ailleurs la conclusion du Marchand de Venise, pièce qui n'en finit
pas d'alimenter les commentaires et les controverses. Shakespeare était-il
antisémite? Son Shylock n'est-il pas l'incarnation du culte de l'argent, cruel
et buté? Ecoutons son intervention célèbre : « Un Juif n'a-t-il pas des yeux ?
Un Juif n'a-t-il pas des mains, des organes, un corps, des sens, des désirs,
des émotions? N'est-il pas nourri par la même nourriture, blessé par les mêmes
armes, sujet aux mêmes maladies, guéri par les mêmes moyens, réchauffé et
refroidi par le même hiver et le même été qu'un chrétien ? Si vous nous piquez,
est-ce que nous ne saignons pas? Si vous nous chatouillez, est-ce que nous ne
rions pas ? Si vous nous empoisonnez, est-ce que nous ne mourrons pas? Et si
vous nous outragez, ne nous vengerons-nous pas? »... En réalité, ce Shylock a
été insulté sans arrêt par ces patriciens vénitiens qui sont bien obligés de
recourir à lui lorsqu'ils ont des dettes. Le mélancolique Antonio a besoin de
lui? Qu'il signe donc ce billet pour trois mille ducats : Shylock, s'il n'est
pas remboursé, pourra prélever sur lui « une livre de chair blanche, à découper
et à prendre dans la partie du corps qui lui plaira ». Personne n'a osé le
dire, mais il est évident que Shylock est amoureux d'Antonio (beaucoup trop),
de même, toujours à Venise, qu'Othello est trop sensible au charme du vénéneux Iago. Il veut de la chair, pas de l'argent, Shylock, erreur
fatale, que sa propre fille, Jessica, éprouve comme un « enfer », au point de
le trahir en lui volant ses bijoux, et en s'enfuyant avec un Vénitien de
charme. Shylock sera condamné, mais sa légende traverse les siècles (on le
retrouve dans Opération Shylock, le
plus beau roman de Philip Roth). Son problème est simple : il est sourd, il
n'entend pas la musique. Il persiste, contre toute raison, à réclamer sa livre
de chair à découper sur le bel Antonio, mais, dit le tribunal, sans verser une
goutte de sang, exploit impossible.
Bien entendu, Freud rôde dans les
parages, car la pièce, extrêmement subtile, met en scène le thème des « trois
coffrets », déjà repérable dans Le Roi
Lear. Voyons ça : la belle Portia épousera le
prétendant qui saura choisir le bon coffret. Le premier est d'or, et porte
l'inscription « ce que beaucoup désirent ». Le deuxième est d'argent, et ce
sera « selon son mérite ». Le troisième est de plomb, et prévient celui « qui
risque tout ce qu'il a ». Les prétendants, y compris « le roi du Maroc», sont
idiots. L'un choisit l'or, l'ouvre, et découvre à l'intérieur une tête de mort.
Celui qui choisit l'argent tombe sur une tête d'idiot grimaçant. Mais voici Bassanio, aimé en secret de Portia,
l'homme pour lequel Antonio a demandé trois mille ducats à Shylock. Il prend le
coffret de plomb, bien joué, il gagne le portrait de la belle. Moralité :
l'argent n'est rien, l'amour est tout.
Philippe
Sollers
William Shakespeare, Comédies (tome I), édition publiée sous la direction de Jean-Michel Déprats et Gisèle Venet, Gallimard, 2013
LE NOUVEL OBSERVATEUR 24 OCTOBRE 2013 - N° 2555
|