|
La société du génie
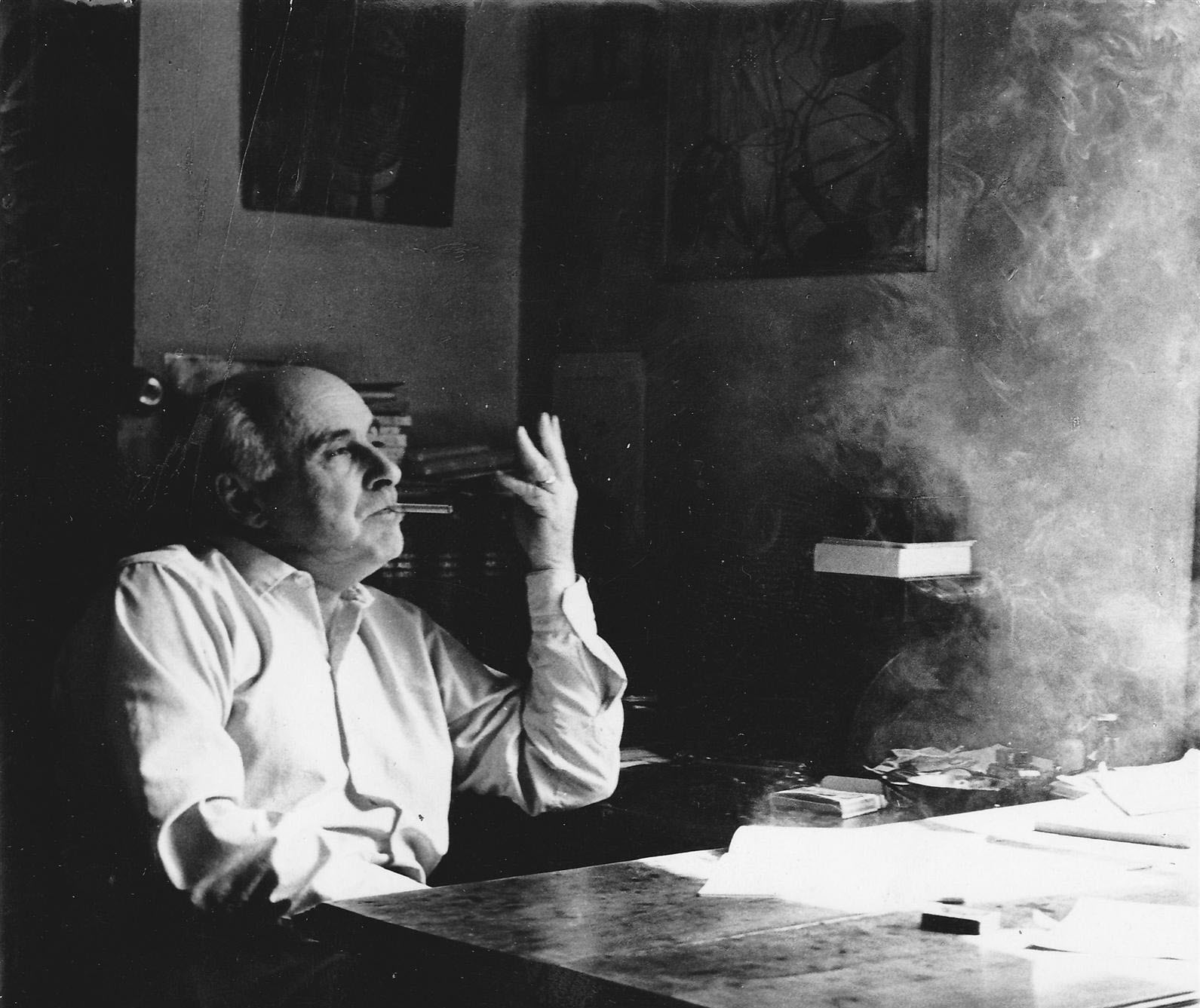 |
| Francis Ponge |
Je revois
le moment de ma première lecture de Ponge, à quinze ans, dans une étude du soir
surchauffée, au hasard d’une anthologie de la poésie française. Quelque chose
d’autre, de vraiment autre, se passait soudain sur la page. Poésie ? Non.
Un escargot ! Prose ? Non plus, à cause de cette drôle de reptation
des mots en train de devenir plus concrets que l’escargot lui-même. J’avais
l’impression d’une hallucination à l’envers. Je venais de lire les
surréalistes, et le retour à la pluie, au cageot, à l’orange, à l’huitre,
jouait comme une passe de désenvoûtement.
Quelques
années plus tard, autre hasard : j’habitais boulevard Raspail, en face de
l’Alliance Française. Des conférences de littérature étaient annoncées :
Francis Ponge. Il n’y avait qu’à traverser la rue. C’est donc là que j’ai
rencontré, entendu, avec deux ou trois amis (on allait vers la fondation de Tel
Quel), au milieu d’étudiants étrangers qui ne connaissaient sans doute pas
leur chance, un des plus grands poètes français. Un jour, il s’est mis à lire les
Hirondelles. C’était inouï.
Nous
sommes vite devenus amis, je repense aux heures de conversations chez lui, rue
Lhomond. Ponge, à l’époque, était très seul, pauvre, son souci était celui de
la transmission, le moment des "œuvres complètes" était loin, il
craignait d’avoir travaillé pour l’ombre. Et en même temps, très sûr de lui,
"tremblement de certitude". J’ai été heureux de publier certains de
ses plus beaux textes, l’Asparagus, par exemple : "Ainsi
l’asparagus étend-il ses tapis, ses tamis superposés, ses tapis étagés, ses
palmes protectrices"...
Tout
lecteur intérieur des Illuminations et de Connaissance
de l’Est entre dans Ponge sans difficultés et peut s’y reposer à
loisir. Le Parti pris des choses est ainsi, avec la
Rage de l’expression, comme un atelier de réparation de l’invention
rhétorique. Pourquoi réparation ? Quelque chose avait explosé ? Sans
doute. Et rien aujourd’hui ne me parait plus touchant que ces notes de Ponge,
communiste et résistant, en 1941, dans le Midi, lorsqu’il prend la décision,
face à l’irrationalisme nazi, de lutter pour la philosophie des Lumières. On
trouve trace de cette décision dans l’exergue inattendue de Voltaire à la
Nouvelle Araignée : "Au lieu de tuer tous les Caraïbes, il
fallait peut-être les séduire par des spectacles, des funambules, des tours de
gibecière et de la musique."
Paralysie,
aphasie : voilà comment Ponge voit la société et l’histoire. D’où la
fameuse déclaration :" Le monde muet est notre seule patrie." Le
dégoût, la répulsion violente au contact de l’emphase et des atrocités
humaines, font de lui un humaniste pour temps de terreur. Ne pas mentir. Ne pas
céder à la psychologie, à la démagogie, au sentimentalisme, au
"ronron", au "manège", qui voilent la beauté évidente du
moindre objet et de sa présence supérieure à tous les discours.
Il y a une
imposture poético-philosophique : mais on peut toujours se dérober,
repartir de plus bas, modestement, orgueilleusement ; faire entendre le
silence, la corde pincée, la couleur, la saveur. Il y a du Webern chez Ponge.
On creuse l’écoute, on affine l’œil, on ouvre le dictionnaire, ce trésor.
L’abricot ? "Deux
cuillerées de confiture accolées." "La palourde des vergers. "
"Nous mordons ici en pleine réalité accueillante et fraiche."
Difficile de manger un abricot sans penser, à un moment ou à un autre, à ces
formules elles-mêmes mangeables. "Un immense pétale de violette bleue".
Et cela
est vrai aussi du mimosa, de la guêpe, de l’oeillet,
ou encore du cheval et de la chèvre (une simple chèvre recommence la vie après
la guerre et les camps, la sculpture de Picasso vient là en écho visible).
Grâce au Carnet du bois de pins, apprenez à être seul dans le Sud
vibrant. Ouvrez les yeux sur le ciel de la Mounine :
"Le ciel n’est qu’un immense pétale de violette bleue." Le sujet
humain a subi une répression et une déportation sans précédents, il ne tient
plus qu’à un fil - les figures de Giacometti. Chaque geste, chaque pas est
problématique, héroïque. Saura-t-il même se laver les
mains ? En éprouver un plaisir naïf, délicieux, comme s’il venait
d’échapper au néant ? Et voici le Savon, un des ballets les
plus "fous" de Ponge, petit opéra baroque en ébullition, danse gaie.
Il n’y a
pas de petits sujets, ou plutôt la moindre chose, la moindre syllabe, peuvent
nous transporter, d’un coup, dans des dimensions inconnues et paradisiaques. Le
Pré, le Verre d’eau... Bien entendu, Ponge a beaucoup médité
sur La Fontaine, et son ambition (la plus déconcertante, la plus à
contre-courant, et peut-être la plus actuelle) aura été d’arriver à des
condensations simples et mémorables, dictons, proverbes, moralités. Le vrai
"post-moderne", en un sens, c’est déjà lui, Lautréamont et
Montesquieu mis sur le même plan, sans coupure, de même que Rimbaud et
Malherbe, Picasso et Chardin. Retour en arrière ? Néo-classicisme ?
Je m’en veux de l’avoir pensé lorsque nous nous sommes perdus de vue. Mais le
"programme" de Ponge me paraît toujours juste : "Il faut
travailler à partir de la découverte, faite par Rimbaud et Lautréamont, de la
nécessité d’une nouvelle rhétorique. Et non à partir de la question que pose la
première partie de leur oeuvre." (My Creativ Method).
Cette
"nouvelle rhétorique" (qui évoque souvent la tentative de Joyce)
donne naissance à des catégories décalées : la réson,
plus fiable que la raison (les mots d’abord, les idées ensuite), et l’objeu (l’homme encombré d’images et d’objets se
met à jouer, comme automatiquement, avec eux). Proust : l’imparfait de
Flaubert renouvelle davantage notre vision du monde de Kant. Le Soleil
placé en abîme, dans cette visée, est un des sommets de Ponge, son
"grand œuvre" désespéré. Froidement, il n’a pas hésité à avouer ses
tâtonnements, ses divagations, ses délires, ses impasses. Il est bien le seul
poète à avoir démystifié l’inspiration poétique, à avoir osé montrer ses
brouillons. Les esquisses de Ponge : ses croquis, ses encres, ses
trouvailles de traits, ses répétitions acharnées.
Je pense
que, pour son tombeau, Ponge eût aimé de la musique : celle de Rameau.
Rameau : "L’artiste au monde qui m’intéresse le plus profondément."
(La Société du génie). "C’est la fronde du dix-huitième siècle
français qui a lancé, dans l’éther intersidéral, ce caillou.".
Cher
Francis Ponge, j’ai été frondeur à vos côtés lorsque cela était nécessaire,
nous avons écouté ensemble les attaques rythmées de Rameau, je vous laisse donc
la parole, que vous me permettrez simplement, selon la tradition, de
ratifier : "On allait, à travers Rameau et sa merveilleuse rigueur
dans la sensualité harmoponique, — vers Fragonard,
vers Sade, vers ce Mariage de Figaro où, dès les premières scènes,
grâce au travesti de Chérubin, l’on se trouve porté en pleine saison
paroxystique du libertin et du libertaire à la fois. "
Ainsi
soit-il.
Philippe
Sollers
Le
Monde du 09/08/88.
|